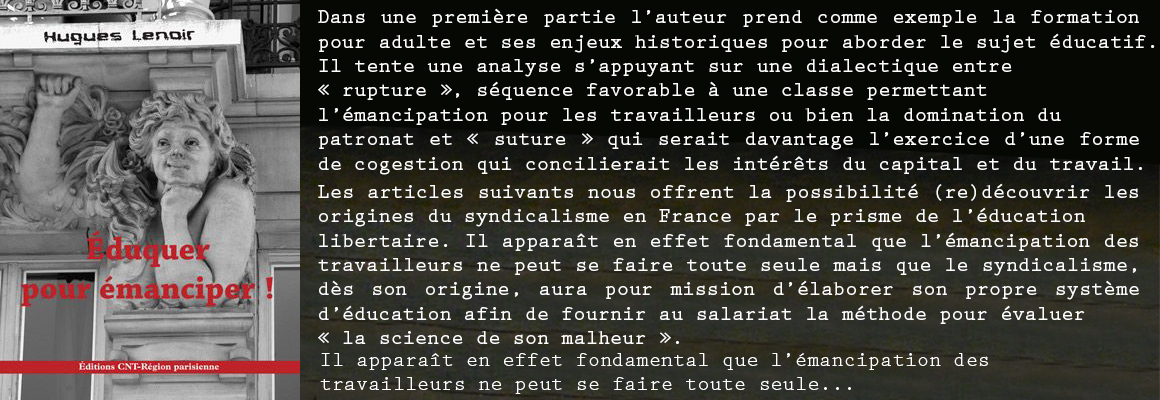Pédagogie : illettrisme, analphabétisme
« L’une des formes essentielles de la domination dans l’histoire a opposé ceux qui détenaient le pouvoir de décrire et d’interpréter le monde au moyen de l’écriture et ceux qui ne disposait que d’un langage oral »1.
«�Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le coeur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur »
�
Prévert, Le Cancre
�
Pédagogie ? Je devrais plutôt employer le terme andragogie mais, compte tenu de son étymologie qui réserve l’éducation au seul homme, il m’apparait totalement exclu de l’employer. Guy Avanzini avait, en son temps, parfaitement signalé le paradoxe.
Il écrivait :
« nous ne disposons pas, actuellement, du concept qui désignerait adéquatement la réflexion sur l’éducation de l’adulte et les méthodes appropriées »
et il considérait que la notion « d’andragogie était tout à fait erronée »2car ne visant que la moitié du genre humain.
Je conserverai ici par facilité de langage le terme pédagogie même s’il est impropre puisqu’il ne convient que pour évoquer l’éducation des enfants. Je lui préfère celui d’éducation des adultes. Plus juste mais aussi moins « parlant » pour beaucoup quant aux méthodes, techniques, outils, conditions de l’apprentissage et à l’accès aux savoirs/compétences dites de base d’adultes en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme.
Le texte qui suit est le résultat de la reprise de notes accumulées au cours des années et issues de nombreux ouvrages et de divers auteurs. Certaines citations pourront paraître anciennes mais elles montrent que la question de l’illettrisme, voire de l’illectronisme, est ancienne. De fait rien n’a vraiment évolué et, pour beaucoup d’adultes, les questions et problèmes posés il y a quelques années sont toujours et encore d’actualité, les formulations ont parfois changé mais le problème de l’illettrisme d’une frange importante de la population perdure.
Afin de mieux cerner la population en question, celle touchée par l’illettrisme, je renvoie à la définition partagée de l’ANLCI3 (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme) formulée par un collectif en 2003. Néanmoins, pour éclairer le lecteur et définir l’objectif de la lutte contre l’illettrisme, voire de l’analphabétisme, je rependrai la définition de la littératie car elle montre vers quoi doit tendre la maîtrise des savoirs fondamentaux.« Le terme « littératie » désigne une aptitude précise, à savoir comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie courante à la maison, au travail et dans la communauté en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses activités.
En définissant un vaste ensemble de compétences reposant sur le traitement de l’information, cette approche conceptuelle souligne la multiplicité des compétences qu’englobe la littératie dans les pays très industrialisés »4. De plus, afin de combattre tout esprit de stigmatisation qui, quelquefois, touche les non lecteurs-scripteurs, il convient de souligner que « les faibles compétences de lecture et d’écriture ne s’observent pas seulement dans les groupes marginaux,mais dans une grande partie de la population adultes5des pays participants [aux enquêtes OCDE]. Les données révèlent que les programmes d’éducation permanente et de formation des adultes sont moins susceptibles d’atteindre ceux dont les compétences laissent à désirer, alors qu’ils en auraient le plus besoin ».
Enfin, sans revenir sur les fonctions sociales de l’écrit6, je soulignerai que, pour la plupart d’entre nous même après de longues études, comme le rappelle Edris Abdel Sayed à la suite de Véronique Leclercq, tout acte d’écriture « est une prise de risques vécue plus ou moins difficilement selon les cas »7. Et j’ajouterai avec Michel Dabène que « les pratiques scripturales quotidiennes ne relèvent pas, en fait, d’un ordinaire langagier. Le recours à l’écrit, si modeste soit-il, est un geste de culture, au sens anthropologique du terme, s’insérant dans un ensemble d’attitudes, de comportements, de représentations définissant un « habitus socioculturel »8 partagés ou pas selon les lieux, les milieux, les époques, les cultures.
La récurrence, une vieille affaire
Voilà fort longtemps que furent constatés des phénomènes d’érosion des savoirs et jusque-là peu de choses ont été faites du point de vue des organisations sociales. L’école ne donne pas toujours les moyens aux enfants de maîtriser leur « apprendre à apprendre » qui leur permettraient d’entretenir et d’améliorer leur niveau de connaissances. Pas plus qu’elle ne développe chez beaucoup le goût du savoir. Quant aux adultes de niveau faible et peu qualifiés, dans la plupart des cas, les situations de travail ne mobilisent peu ou pas l’écrit ce qui facilite le non usage et les déperditions.
Une étude de l’OCDE rapporte qu’une « campagne nationale d’alphabétisation sur une très grande échelle avait débuté au milieu des années 40. Elle visait à enseigner aux adultes à lire et à écrire avec le concours de volontaires et de matériaux simples. Mais cette tentative a échoué, car les adultes n’avaient pas l’usage des simples connaissances de lecture et d’écriture acquise en quelques mois et sont donc retombés dans l’analphabétisme »9.
Constats quasi permanents faits par les formateurs suite à la mise en place de dispositifs d’apprentissage non pérennes et par trop souvent conjoncturels. Erosion des savoirs/compétences de base encore constatée par la même organisation lors d’une autre enquête dont les résultats « semblent indiquer que les gens peuvent perdre une certaine partie de leurs savoirs fondamentaux si ceux-ci ne sont pas maintenus par une pratique régulière et exigeante à la maison et au travail »10. Même situation en France dans les années 1960 lors des débats sur la promotion sociale.
Dans un texte anonyme intituléLa promotion sociale malade du développement culturel, l’auteur écrivait
« par la force des choses il existe une dégradation culturelle énorme – véritable déperdition d’énergie, à tous les niveaux culturels. Le phénomène – tout comme celui de pauvreté culturelle – est encore mal analysé. Cette dégradation est due à la pression de la vie quotidienne, la prégnance du milieu, aux déformations du métier. Aux niveaux les plus bas, les connaissances, les réflexes mêmes s’effritent très rapidement : tel qui lisait à 12 ans ne lit plus à vingt ans. On assiste – surtout au niveau moyen – à un écart sensible entre le niveau culturel et l’emploi exercé, provoquant une dégradation rapide »11.
Plus récemment Yves Clot rapportait que ce phénomène de déperdition touchait l’ensemble de la population, y compris les enseignants dont il livre un témoignage en ces termes :
« au bout de quinze ans d’enseignement, on est redescendu au niveau des élèves, et puis c’est tout. Au bout de quinze ans on désapprend. Finalement, quand on reprend les études, on s’aperçoit, je crois, que ça revient plus vite »12.
Témoignage optimiste malgré tout car il laisse penser que les savoirs ne sont que partiellement oubliés et/ou enterrés et qu’il est possible de les revivifier.
�
Donner du sens au savoir et soutenir la motivation
Autre évidence aujourd’hui, la question du sens des apprentissages et de la motivation pour les soutenir que les travaux de Bernard Charlot et Philippe Carré ont, entre autres, largement soulignés. Là encore, il n’y a rien de nouveau, lors d’un colloque de l’AFPA à Lille en 2004 Claude Lemoine déclarait :
« la formation est possible et porteuse de progrès si elle a un sens pour l’apprenant.
Il ne suffit pas de participer ou même de réaliser, il faut que cette activité soit signifiante pour l’intéressé, qu’il participe, la projette, l’inscrive dans sa perspective personnelle »13.
C’est ce que rappellent Etienne Bourgeois après Pierre Dominicé. Pour eux, « les apprentissages les plus marquants dans une vie sont ceux dont l’objet représente un enjeu vital pour le sujet au moment où ils produisent dans la trajectoire de celui-ci.
Est-ce à dire que l’apprentissage n’est possible que s’il touche à des comportements et des connaissances fortement « investis » par le sujet (…) ? »14, à mon sens très probablement la qualité et la quantité des apprentissages informels faits au hasard des centres d’intérêts en sont un élément de confirmation.
Question du sens qu’il ne faut pas déconnecter de la motivation et de la reconnaissance. Sans ces leviers l’activité pédagogique a beaucoup moins de chance de porter ses fruits et à terme d’éviter la récurrence de l’illettrisme. Pour l’OCDE, organisation libérale s’il en est : « il ressort clairement de cette étude que l’éducation prend réellement effet et que les apprenants sont plus motivés quand ils perçoivent le rapport évident entre ce qu’ils apprennent et leurs besoins pratiques, et quand ils entrevoient la possibilité de transformer leurs vies, individuellement ou collectivement.
Cela veut dire que l’enseignement dispensé doit être davantage qu’une série compartimentée de connaissances théoriques et pratiques. La difficulté consiste pour les décideurs à s’assurer que le « programme d’études » offert répond bien aux besoins et aux désirs des adultes exclus »15. En effet, pour stimuler la formation tout au long de la vie, il faut « que les résultats atteints par toutes les catégories d’apprenants soient reconnus et récompensés par une amélioration de leurs perspectives d’emploi et de leurs conditions de vie »16. La reconnaissance pour soi et de soi ainsi que la reconnaissance sociale des effets de la formation apparaissent comme des déclics essentiels à la réussite des dispositifs d’apprentissage.
Une note du CEREQ affirme d’ailleurs que l’engagement et « l’appétence » des salariés pour la formation semblent au final trouver leurs ressorts dans une plus grande visibilité de la formation : une plus grande visibilité de ce qui est fait et de ce qui peut être fait en la matière, mais aussi des avantages que le salarié peut en attendre, y compris lorsque ceux-ci se limitent à garantir unstatu quo (emploi, qualification…) que de nombreux travailleurs parmi les moins qualifiés peinent parfois à sauvegarder »17. Ainsi pour entretenir cette (auto)-motivation implique : « du temps ou plutôt ténacité et continuité […].
Il faut tenir, plus que se maintenir, ce qui signifie que la formation demande d’être relayée, de trouver des prolongements […]. On peut sans doute généraliser. La formation est nécessaire, mais, seule, ne suffit pas. Elle s’inscrit dans un contexte social qui réduit ou accroît les transformations et les résultats amorcés »18.
Tenir compte des contingences pour faire apprendre est sans doute déterminant mais l’individu n’est pas que raisonnable, il est aussi fait d’affect et de sensibilité. Comme le souligne Pierre-Marie Mesnier :
« tout objet à connaître entre en liaison affective avec un système de références préexistantes chez le sujet apprenant [d’une part]. D’autre part, il s’enracine à l’origine dans le désir de connaître dont dépend le désir d’apprendre »19.
En d’autres termes, ne jamais oublier le sujet comme acteur-auteur de ses apprentissages car « acquérir, et surtout réacquérir, les savoirs de base (ou combler des lacunes anciennes dans cette acquisition)nécessite l’action du sujet dans une perspective de réalisation »20.
�
Tenir compte des environnements et des histoires personnelles
Ceux qui travaillent avec des adultes en situation d’illettrisme savent combien peut être déterminant l’environnement familial et social dans la relation aux apprentissages. La place du livre dans la maisonnée, le rapport au savoir, la place des cultures et langues d’origine, le niveau d’éducation des proches… Ainsi se poser la question du sens comme ci-dessus, c’est : « s’obliger à une « lecture en positif » de la réalité sociale et scolaire, en se refusant à interpréter immédiatement cette réalité en termes de manques, de lacunes, de « handicaps » […]. Comprendre un phénomène, c’est d’abord analyser sa logique propre, sa genèse spécifique.
Cela implique que l’on étudie l’échec ou la difficulté scolaire (ou l’illettrisme H.L.), non pas comme absence de réussite, mais comme expérience, évènement spécifique, ayant une forme de rationalité. L’échec scolaire est événement, ou série d’événements, dans une histoire personnelle qui doit être pensée dans son contenu propre »21. Mais tout n’est pas définitivement arrêté car si « les processus scolaires [sont] socialement structurés (reproduction sociale H.L.) et ne [sont] pas simplement des interactions qui se produisent en classe est certain. Mais il n’en reste pas moins que tout n’est pas joué d’avance, que ces jeunes ont une histoire, au sens plein du terme, une histoire où se produisent des événementsdéclencheursouaccélérateurs »22.
Ce qui vaut pour les enfants vaut probablement aussi pour les adultes. L’illettrisme est donc le résultat et la conséquence d’une histoire singulière dans un environnement peu propice à l’apprentissage pour un individu mais pas forcément pour un autre d’ailleurs. Ainsi, si tous les environnements ne sont pas facilitant, tout n’est pas définitivement joué et certaines situations pourront permettre d’inverser la donne.
D’autant que nous savons aujourd’hui que tout adulte dans des situations favorables peut relancer ses processus d’apprentissages grâce à son potentiel d’éducabilité cognitive. Aux formateurs en coopération avec les apprenants de trouver, construire et faire vivre des situations sociales et formativesdéclenchantesetaccélérantes.
�
Quelle pédagogie, quels outils pour apprendre ?
La question de l’outillage pédagogique est au cœur de la problématique de l’illettrisme et de l’analphabétisme. Existe-t-il une pédagogie spécifique aux adultes dans ces situations ? La plupart des intervenants estiment que non, même si les publics relevant de l’analphabétisme et/ou de l’illettrisme ont leurs spécificités maisde facto comme tout apprenant fort de ses singularités, sa culture, son fonctionnement cognitif… Malcolm Knowles citant Lindeman, un pionnier de l’éducation et de l’apprentissage des adultes dans les années 1930, écrit que celui-ci concevait « l’éducation des adultes comme une technique nouvelle d’apprentissage qui est aussi essentielle pour un diplômé d’université que pour un ouvrier analphabète »23. Donc, selon eux, quel que soit le public et son niveau, le même ensemble de techniques est à mobiliser.
Fort de ce principe, en matière d’éducation des adultes, quelques constantes peuvent être repérées. Tout d’abord, il convient de tenir compte de la zone proximale de développement du sujet. Pierre Pastré s’y réfère explicitement. Il écrit :
« l’instructeur peut gérer la complexité de la situation, en particulier faire fonctionner ses stagiaires dans ce que Vigotski appelle « zone de proche développement »,
c’est-à-dire dans une complexité juste suffisante pour qu’ils soient en situation de résolutions de problème sans être noyés dans la situation. Le principal procédé consiste pour l’instructeur à diminuer les degrés de liberté de la situation, en prenant éventuellement une partie de la tâche à son compte. […].
Les instructeurs ne sont ni des enseignants ni des tuteurs, mais des spécialistes de l’étayage de compétence qui soit précis, de qualité et contrôlé. […] Dans la formation des compétences le rôle d’autrui est très important. Mais cet autrui n’est pas seulement un expert. Ce n’est pas non plus seulement un formateur, chargé de transmettre les connaissances utiles. Son rôle principal consiste dans sa manière de gérerla complexité de la situation, pour qu’elle soit juste suffisante, pour que les agents apprennent vraiment » 24. D’où une grande compétence des formateurs et pour beaucoup un changement de posture. Si l’on s’accorde sur l’éducabilité cognitive des adultes, il faut aussi maintenir un cadre pédagogique favorisant les échanges et autres éléments de posture, s’inscrire dans des pratiques pédagogiques de type socioconstructiviste.
Les interactions entre pairs facilitant par l’échange la construction des savoirs. C’est ce que Maryvonne Sorel rappelle :
« la modification cognitive serait donc une réalité naturellement accessible à toute personne mais son avènement, sa réalisation seraient néanmoins assujettis à des conditions d’environnement, dont les situations éducatives sont une forme particulière. Il s’agirait donc d’une propriété conditionnelle qui s’exerce dans le cadre de relations interactives et circulaires [SujetEnvironnement] »25.
Opinion partagée par d’autres chercheurs qui affirment :
« On le voit, il ne faudrait pas limiter les apprentissages des opérateurs à une simple acquisition de connaissances nouvelles, la découverte et l’exploitation du système relationnel sont au moins aussi importantes »26.
Ce que résument fort biendeux militantes ayant suivi le cycle de l’EFD (école des dirigeants) dans les communautés indiennes de laRed Puna sur l’altiplano andin qui ressemble aux pratiques de l’EZLN dans le Chiapas mexicain : « Eugenia et Maria Guadaloupe, membres de la commission formation, rappellent qu’au sein de l’EFD on apprend tous ensemble, en s’appuyant sur les savoirs de chacun.
Des savoirs qui sont parfois bien cachés parce qu’on se dit qu’on ne sait pas lire ou écrire, parce qu’on n’a pas terminé l’école… « Ici, affirment-elles, il ne s’agit pas de cela, il s’agit d’apprendre en se servant de la sagesse de chacun »27.
Autres conditions d’apprentissage durable, la nécessité de « l’apprendre à apprendre » déjà prônée par Montaigne au 16e siècle puis par Sébastien Faure à la Ruche dans les années 1910. Ainsi, « Favereau […] montre en quoi les aptitudes de compréhension, mémorisation et inférence sont au cœur de ces capacités d’apprentissage. C’est leur acquisition qui permet à l’individu de mettre en œuvre des stratégies face à l’imprévu et au changement. L’acquisition du « savoir apprendre » devient l’objectif clé en matière d’éducation et de formation dans les économies fondées sur la connaissance »28.
Autre invariant pédagogique semble-t-il, le recours à la pédagogie active et parfois à l’individualisation des parcours. Le témoignage d’une apprenante, Valérie, le souligne : « ici, c’est totalement différent de l’école car on est autonome en quelque sorte. Les formateurs sont là pour nous aider à progresser. Ils ne font pas un cours, c’est nous qui devons travailler, aller chercher l’information dans les classeurs, les manuels. On n’attend pas, on agit »29.
Elle ajoute plus loin : « travailler seule, et dans le silence, cela me permet de progresser à mon rythme, de mieux cerner mes propres lacunes […]. On est pas (sic) dans une classe ou certains « s’en sortent » et les autres sontlaissés de côté […]. Notre objectif est d’acquérir par nous-mêmes les connaissances. Travailler seuls nous obliger à nous organiser, à nous responsabiliser vis-à-vis de notre formation. Il faut être motivée car ce n’est pas facile. Ce n’est pas évident l’autonomie. Au début on a tendance à demander beaucoup de choses aux formateurs. Ce que j’aime ici c’est justement la relation que l’on établit avec les formateurs. Ils sont plutôt sympas.
On n’a pas de relation prof-élève comme à l’école. Ils ne nous jugent pas. J’avais peur en venant ici du regard des autres mais cela se passe plutôt bien »30.Enfin, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus et à utiliser tout autre moyen pour accéder ou faire accéder au savoir et à la maîtrise de la langue comme le suggère Edris Abdel-Sayed.
Pour lui :
« les visites à caractère culturel (musées, monuments), la fréquentation des lieux de spectacles (théâtre, cirques, concerts), les pratiques artistiques amateurs (musique, danse, théâtre) »31
… sont autant de supports pédagogiques et de prétextes d’apprentissage possibles.
Tout comme le sont les situations non-formelles ou informelles déjà évoquées par Ettore Gepli dès 198932. C’est aussi le constat que faisait l’OCDE. Pour cette organisation « bien que les périodes initiales soient importantes, les expériences et le milieu socio-économique d’une personne à l’âge adulte peuvent avoir une incidence spectaculaire sur ses savoirs fondamentaux.
Les gens peuvent donc améliorer leurs compétences »33 ou encore, elle affirme « que l’éducation, qu’elle soit formelle ou non, scolaire ou extra-scolaire, constitue une partie essentielle de l’arsenal de lutte contre l’exclusion »34. Ce qui conduit Claire Bélisle à écrire :
« la non-reconnaissance des savoirs d’expérience des non-diplômés est certainement l’élément qui pèse le plus dans la représentation dépréciée de « l’élite »
à l’égard des potentiels de la grande majorité des salariés et des chômeurs »35 particulièrement les plus faiblement qualifiés.
�
Plus pragmatiquement
�
Je formulais, quant à moi dans un rapport de recherche réalisé pour DGEFP en 2006, quelques recommandations en matière de qualité pédagogique de la formation et de posture des formateurs :
�
- la mise en place de relations pédagogiques et d’un climat favorable aux apprentissages basé sur la confiance, l’empathie, l’écoute…,
- la « déscolarisation » des pratiques ou en d’autres termes la mise en œuvre réelle d’un « faire » andragogique,
- la gestion d’un groupe hétérogène aux motivations diversifiées,
- la mise en œuvre d’une pédagogie du projet,
- la définition de parcours personnalisés et la gestion des projets personnels et professionnels,
- la mise en place d’une pédagogie différenciée et/ou individualisée,
- l’animation et la régulation de groupes d’une grande hétérogénéité,
- des possibilités de co-animation,
- la recherche d’une certaine interdisciplinarité (savoirs de base, législation, histoire, organisation administrative…),
- l’usage raisonné de l’évaluation et d’outils de mesure des apprentissages,
- une relative maîtrise des processus d’alternance (gestion des stages pratiques),
- l’initiation à l’usage systématique et approfondie de l’ordinateur et à la navigation sur internet36.
Pierre Roche de son côté affirme quela réussite d’une formation en direction des premiers niveaux était liée à quatre conditions :
« le respect de certaines formes de temporalité ; l’obtention d’informations claires sur des objectifs en termes d’emploi, de classification, de salaire ; la mise en place de procédures pédagogiques faisant rupture avec l’univers scolaire ; enfin, la reconnaissance de soi par les autres, et ce dans l’acte formatif mais aussi dans la réalité quotidienne du travail »37.
Enfin Sawsan Hanouz, dans son mémoire, rappelait aussi que, depuis fort longtemps, les choses avaient été dites et les constats opérés. Elle propose quelques repères pour l’action sous forme d’une excellente synthèse des pratiques pédagogiques en direction des publics en situations d’illettrisme et/ou d’analphabétisme. Hanouz note en effet que « Les multiples courants pédagogiques ont chacun mis l’accent surdifférentes « variables-leviers�» susceptibles d’améliorer les apprentissages, notamment des personnes en difficultés : l’intérêt (Claparède), l’action sur les objets (Freinet, Piaget, Dewey, Aumont-Mesnier), la qualité de la relation personnelle (Rogers et Neill), l’importance de l’interaction sociale (Cousinet), le désir de savoir (Oury), la confiance et la coopération (Lenoir), le groupe et le conflit socio-cognitif (Bourgeois et Nizet), l’individualisation et la pédagogie différenciée (Meirieu), la motivation et la quête identitaire (Carré, Kadouri).
Inversement, il peut exister des «�variables freins » tels la non disponibilité d’opérations mentales (Piaget), le poids de déterminismes sociaux (Bourdieu), la négation de l’adulte comme sujet apprenant et la rescolarisation (Lenoir), ou l’absence de modèles d’identification » 38.
Pour conclure ce propos sur la pédagogie et la pédagogie de l’écrit en particulier, il convient de se rappeler lorsqu’on œuvre sur ce terrain comme à la suite d’André Ouzoulias que « l’apprentissage de la lecture est difficile et exige du sujet un entraînement soutenu et régulier. Si nous le perdons de vue, c’est d’abord parce que la lecture nous est très facile aujourd’hui et ensuite parce que nous avons oublié les centaines d’heures que nous avons passé à lire et à écrire, laborieusement, avant de devenir aussi habile que nous le sommes au maniement de la langue écrite »39.
Et le numérique alors ?
Nous aurions pu penser que, dans ce domaine, peu de choses avaient été dites à l’aube des années 2000 mais là aussi de nombreux constats avaient été formulés. Dès 1999, une étude de l’OCDE attirait l’attention sur le risque technologique pour certaines populations.
« La compétence et l’assurance acquises dans l’utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) donnent un bon exemple qui englobe toute la gamme des objectifs : professionnels, sociaux ou personnels. La maîtrise des TIC est de plus en plus indispensable à l’intégration dans tous les aspects de la vie contemporaine. L’acquisition de ces compétences mérite d’occuper une place de premier plan dans la lutte contre l’exclusion sociale »40.
Michel Authier formulait la même inquiétude. « Il est clair, écrivait-il, que ces prothèses (technologiques [NTIC]), de la mémoire, du raisonnement, de la communication, auront un effet de libération considérable des facultés de créativité et d’invention pour ceux qui pourront en bénéficier. Par contre, l’exclusion de ceux qui seront tenus à l’écart sera encore plus sévère »41.
En effet, aux trois compétences « traditionnelles » de la société industrielle (lire, écrire et compter) s’ajoutent maintenant la compréhension et l’organisation de plusieurs « couches » d’information indispensable pour exercer un métier aujourd’hui. […mais] ces différentes couches d’information sont de plus en plus souvent accessibles uniquement par des technologies qu’il faut maîtriser »42 d’où des difficultés accrues pour certains. C’est le constat fait par Battaglia en 2000. Il écrivait déjà :
« de toute évidence, le vécu et la pratique des stagiaires confirment les intuitions des formateurs : on ne réussit que si l’on possède des compétences minimales (capacité à organiser sa démarche de formation, à gérer son temps, à s’orienter dans les supports d’apprentissage).
�
Les apprenants les plus fragiles affirment fréquemment avoir été écrasés par l’ampleur des tâches et très rapidement étouffés par un dispositif dans lequel ils ne parviennent pas à trouver des repères.
�
De plus, les contacts avec les tuteurs, les accompagnements, les aides ne sont efficaces que si les stagiaires réussissent à formaliser leurs difficultés, faute de quoi la prise en charge reste vague et devient vite insuffisante pour provoquer la réussite ».
Il poursuit :
« loin d’estomper les différences entre stagiaires, la formation à distance creuse un fossé entre ceux qui sont capables d’acquérir une autonomie et ceux qui se révèlent incapables de gérer les tâches exigées pour rendre efficaces les apprentissages.
�
�
C’est pourquoi il importe d’être prudent sur l’effet produit par la liberté d’apprendre à son rythme et à sa guise : facteurs de progression et d’épanouissement pour certains, elle est également pour d’autres source d’échec d’autant plus durement ressentie que la culpabilisation s’y rattache.
�
�
De fait, nous avons été sensibles aux remarques désabusées d’apprenants débordés par une autonomie qu’ils ne réussissaient pas à construire et à utiliser avec pertinence : ils se dévalorisent, se jugent incapables d’acquérir la moindre compétence.
�
Bref, le sentiment d’échec domine »43.
Il y aurait donc après l’insécurité linguistique, un risque d’insécurité technologique.
Risque aujourd’hui avéré. C’est ce que les dernières statistiques font remonter : « En 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année, tandis que 38 % des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2 % sont dépourvus de toute compétence. Ainsi, l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population. Une personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de communiquer via Internet.
Les personnes les plus âgées, les moins diplômées, aux revenus modestes, celles vivant seules ou en couple sans enfant ou encore résidant dans les DOM sont les plus touchées par le défaut d’équipement comme par le manque de compétences. En France, le niveau global de compétences numériques est semblable à la moyenne européenne »44.
Numérique encore
Si le risque technologique existe bien, l’utilisation pédagogique des ressources numériques peut aussi avoir des effets positifs sur les apprentissages. Pour certains auteurs, les TIC« contribuent au renouvellement de certaines thématiques, comme celle de la métacognition. En effet, nous avons montré, écrivent Legros et Maître, comment certains usages des TIC semblent favoriser les processus de contrôle et de régulation des apprentissages de l’apprenant »45.
Effets sur les apprentissages anticipés par quelques-uns dès 1996. « Actuellement, pouvait-on lire dans le bulletin du CUIDEP, apprendre par réseau consiste encore, pour l’essentiel, à manipuler du texte écrit, ce qui exige une compétence scolaire minimale de la part des apprenants. L’arrivée des réseaux multimédias avec images sonores et animées et visioconférences en direct modifiera notablement ces exigences »46 rendant pour certains les apprentissages plus aisés à condition toutefois de pouvoir mobiliser les toujours essentielles compétences de bases.
Parmi les outils qui relèvent du numérique le traitement de textes et l’imprimante apparaissent comme des ressources modifiant sensiblement et positivement, pour les apprenants, le rapport à l’écrit et à l’erreur. Ce qui est peut-être déterminant pour eux afin de dédramatiser le rapport à la chose écrite. Une longue citation de Jacques Legros éclaire cette problématique. Pour lui,
« une première caractéristique est souvent invoquée par les promoteurs de ce type de logiciel (traitement de textes) à l’école. Il permet aux élèves une mise en forme, une « mise au net » finale de leurs textes très gratifiante pour les intéressés. Les élèves, et en particulier les plus jeunes et les plus maladroits du point de vue graphomoteur, sont ainsi capables de produire des écrits d’une bonne qualité esthétique, tant sur écran que sous forme imprimée ».
Il ajoute,
« dès lors que les erreurs peuvent être facilement corrigées, le statut de l’erreur n’est plus le même. Non plus faute, sanctionnée par l’enseignant et considérée par l’élève comme un échec, mais savoir provisoire […]. Le traitement de textes permettrait à l’élève des essais dans le domaine de la langue écrite cette fois, dans un rapport à l’erreur déculpabilisée ».
Jacques Legros poursuit :
« lorsqu’on interroge des élèves, ceux-ci déclarent qu’ils aiment utiliser l’ordinateur pour écrire, qu’ils ont moins peur d’être jugés négativement, qu’ils ont l’impression de progresser et qu’ils sont fiers de leurs productions (Cochran-Smith, 1991 ; Hawisher, 1989). Aussi n’hésitent-ils pas à passer plus de temps sur leur travail.
�
Des auteurs ont également noté une plus grande concentration sur la tâche (Landreville, 1995, Cochran-Smith, 1991) ».
Et il conclut :
« c’est l’interaction du facteur « traitement de textes » avec d’autres facteurs propres au sujet ou appartenant au contexte qui favorisent l’apprentissage et améliorent les performances. L’ordinateur, et plus précisément le traitement de textes, n’est qu’un élément dans une « configuration » de facteurs et de variables qui interagissent dans les activités d’apprentissage »47.
De fait, ici encore, entre en ligne de compte la dimension socioconstructiviste des apprentissages entre pairs et entre formateur et apprenant(s).
Constat sur les dynamiques d’apprentissage que j’avais moi-même dans mes travaux de recherche mises en évidence en 2002 dans un rapport intituléAdultes en situations d’illettrisme et formateurs : rapports aux technologies.
Je constatais alors que durant leurs interventions, lorsque les apprenants se servent à la fois de logiciels spécialisés et des ressources « brutes » de l’ordinateur, à savoir le traitement de texte et l’imprimante, ces deux outils facilitent le rapport à l’écrit. « Mythe libérateur, écrivais-je, encore renforcé auprès de notre échantillon par le pouvoir de correction automatique et de surlignement dont sont dotés les traitements de textes modernes. L’ordinateur apparaît alors comme réparateur du traumatisme orthographique dont on connaît les effets dévastateurs sur le passage à l’écrit, tout comme l’imprimante, nous l’avons montré ailleurs48,restaure de son côté les capacités à produire de l’écrit si ce n’est la capacité graphique »49.
Quelques propos recueillis à l’époque en témoignent :
«Je vais faire mes devoirs dessus, pouvoir faire mes dictées et en même temps, ça va corriger tout de suite».
�
«C’est vrai, l’ordinateur, ça dispose les phrases bien comme il faut, ça corrige les fautes, tout […]. Si l’ordinateur corrige mes fautes, c’est sûr que j’apprends plus».
Ce que confirmaient des formateurs
«Mais il n’y a déjà plus le maintien du crayon, il n’y a plus l’effort d’écrire soi- même, c’est tout de suite un résultat net […].
�
Le clavier, ça ne lui fait pas peur, c’est bien écrit comme sur un livre […].
�
On arrive à produire quelque chose qui est propre et joli […].
�
On oublie un petit peu trop vite l’effort que c’est pour certaines personnes de tenir un crayon et d’arriver à écrire leur nom et leur adresse […] et puis on peut revenir dessus, on peut corriger».
�
«C’est beau pour eux, c’est extraordinaire d’arriver à un travail très beau, très propre, très bien présenté […], c’est extrêmement satisfaisant»50.
En bref tout change et rien ne change, certes les tablettes et les téléphones portables, l’accès à internet ont quelque peu modifié les usages pédagogiques du numérique,mais aujourd’hui encore ils portent les mêmes risques et les mêmes potentialités d’apprentissage.
�
Numérique toujours
L’arrivée de la pandémie COVID a largement mobilisé les ressources numériques pour tenter de pallier l’impossibilité des apprentissages en situation physique de formation. Il a été constaté que les apprenants les plus fragiles et/ou les plus éloignés du numérique ont rencontré de nombreux obstacles à leurs apprentissages de la langue à la fois du fait des technologies mais aussi du manque d’échanges, d’interactions et de débats oraux sans médiatisation51.
A l’exception toutefois de quelques rares apprenants qui purent du fait de l’intermédiation pédagogique trouver d’autres manières d’apprendre. Pour de nombreux jeunes ou moins jeunes, allophones ou en situation d’illettrisme, la Covid et l’usage du numérique furent l’occasion de multiples décrochages. En effet, l’apprentissage à distance nécessite du confort pour apprendre et rester concentrer sur la tâche. Un espace physique et calme est requis mais de nombreux apprenants ont des conditions de vie difficile et l’étroitesse des logements a souvent rendu cette condition très aléatoire d’autant que les habitations étaient aussi le lieu de la concentration familiale.
De plus, l’apprentissage en ligne impose de bénéficier d’une connexion de bonne qualité et de pouvoir en supporter le coût – on a constaté sur ce point les difficultés durant une période à l’Education nationale – De surcroit, il exige aussi de pouvoir jouir d’un matériel performant (tablette, ordinateur). Les téléphones portables étant bien souvent très insatisfaisants sur la durée. Matériel qui dans bien des cas dû être partagé avec d’autres utilisateurs dans les familles etde factopas toujours disponible. Enfin, le distanciel impliquait souvent aussi d’utiliser des outils tel que Jisti et autre Zoom qu’il a fallu « apprivoiser ».
En bref l’apprentissage en ligne, même s’il est parfois une solution, pose questions du fait d’une relation pédagogique amoindrie, d’interactions réduites et médiatisées. Il exige une motivation sans faille et une capacité forte à rester à l’écoute de l’autre, le tout dans un environnement technologique compatible avec les exigences de l’engagement en formation. Pas si simple.
�
Le rapport à « l’école » comme déterminant
La réussite des apprentissages-adultes passe souvent par des pratiques pédagogiques déscolarisées et actives mais aussi par une dédramatisation des passés douloureux et des traumatismes scolaires. Pour certains des apprenants, des souffrances scolaires physiques et/ou symboliques ont parfois entamé ou inhibé leurs capacités d’apprentissages. Une nuance toutefois, cette réalité est celle d’adultes en situation d’illettrisme, rarement pour les apprenants relevant de l’analphabétisme qui entretiennent souvent un rapport positif à l’institution école, à ses acteurs et aux savoirs qu’ils permettent d’acquérir.
Néanmoins ces traumatismes et ses rapports difficiles avec l’école existent, il faut en convenir et ils furent pointés depuis longtemps aussi. Gérard Malglaive s’en faisait l’écho dès 1990 dans son ouvrageEnseigner à des adultes. Il écrivait :
«les formateurs ont souvent dû constater que les salariés, et parmi eux les plus défavorisés professionnellement, socialement et culturellement, n’exprimaient guère de «besoins» de formation […en raison de] nombreux facteurs objectifs parmi lesquels leur propre itinéraire scolaire marqué par l’échec»52.
Propos confirmés dans un rapport de la DGEFP quelques années plus tard.
L’on pouvait y lire:
« beaucoup d’actifs, et en particulier les plus bas niveaux de qualification, ne souhaitent pas reprendre un parcours long de formation, synonyme pour eux de « retour à l’école »,
alors même que leur expérience professionnelle apporte la preuve qu’ils détiennent des compétences bien plus élevées que leur niveau scolaire ne l’atteste »53. Ce qui a pour conséquences, lorsque le retour en formation néanmoins se fait, que l’on constate en France (Presse 2004) […] « que le désengagement, en début de processus, touche plus de personnes non diplômées que de personnes diplômées ». Ce qui renvoie aussi chez certains une « aversion pour les examens qui leur paraissent stressants et qui les confrontent bien souvent à des échecs »54 y compris dans les processus de validation des acquis d’une� expérience (VAE) pourtant souvent assez riche.
Au-delà des difficultés liées à des échecs anciens qui ont entraîné des résistances à la scolarisation ou à la rescolarisation, on constate d’autres fois des causes socialement plus inquiétantes. Dans une recherche-action conduite en 2016-2018, j’ai pu constater que des faits de violence pouvaient entraîner des phénomènes de décrochage mais aussi de grandes difficultés voire de souffrance lors d’une tentative d’engagement en formation une fois adultes. Quelques propos recueillis alors illustrent ces violences peu propices à un parcours scolaire réussi.
Ma maîtresse
«me prend par le bras et m’amène vers l’évier qui se trouvait dans la classe, me met la tête sous l’eau pour soi-disant me rafraîchir les idées… L’eau était gelée».
�
«A l’âge de six ans, je suis entrée au cours préparatoire mais là le maître m’a mise au fond de la classe avec de jolis stylos et de jolis jouets pour que je ne m’ennuie pas. Je me suis mise à détester l’école ».
« Au collège, les professeurs m’ont mise au fond de la classe et m’ont dit que je devais me faire opérer des yeux et que de toute façon, j’étais nulle et que je ne ferais jamais rien de ma vie ».
«Je me suis bloquée, et rien ne sortait ni de ma tête ni de mon stylo »55.
Autre témoignage dans la littérature réaliste nord-américaine où une jeune décrocheuse tient ce propos :
« j’ai toujours vraiment aimé l’école, seulement l’école m’a jamais aimé on dirait »56.
Et pourtant malgré tout un aveu-souvenir qui déclenchera un retour une fois adulte en formation
« c’est sûr : je n’aimais pas l’école, mais j’aimais apprendre »57.
Laissons au grand Jacques Prévert le soin de clore ce paragraphe :
«�Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
�
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur »
�
Le Cancre
�
Pour conclure
Quelques rappels enfin pour clore ce texte. D’abord une leçon de modestie à laquelle nous invite Bernard Lahire.« On se rend compte […écrit-il], qu’en français existe un vide énorme entre les deux extrêmes que représentent « illettré » et « lettré ». La grande majorité de la population française n’est, selon la définition dominante des termes, ni « illettrée » ni « lettrée »58. Même souci chez Anne Torunczyk que l’on retrouve aussi dans la définition de l’illettrisme de l’ANLCI.
Elle se proposait « de démontrer que, lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il « ne sait pas » lire ou écrire, on n’a rien dit : il y a toutes sortes de façon de « ne pas savoir » lire, écrire – et surtout, il y aune quantité de savoir dans ce non savoir ». Elle poursuivait : « de même définir les « illettrés » comme des gens qui ne « savent pas » parce qu’ils n’ont pas pris ou gardé le savoir qu’on leur a donné à l’école est une manière absolument réductrice de les considérer, et de considérer l’apprentissage […].
D’une manière générale, à chaque fois que l’on regarde les individus exclusivement sous l’angle de leurs déficiences, de leur « ignorance » et de leur « incapacité », on peut être sûr de ne rien voir et de ne rien comprendre. C’est le meilleur moyen, pour un enseignant, un formateur, de se rendre inefficace, impuissant à enseigner, à former »59. Position qu’à l’évidence je partage.
Une preuve peut-être de notre aveuglement relatif de « sachant » nous est rapportée par Joan Brady dans un roman sociologique et familial. Il écrit à propos de son aïeul qui vécut aux USA dans le Kansas à la fin du 19e siècle et au début du 20e :
« Mon grand-père savait un peu écrire. Il avait griffonné des lettres sur le sol de la hutte des Stoke (une famille de fermier), mais en fait il n’avait jamais écrit sur une feuille de papier. C’était un des nombreux secrets qu’il avait cachés »60.
Malgré tout l’écrit demeure encore plus qu’hier un outil incontournable tant pour une insertion sociale et professionnelle que pour l’économie hexagonale comme le soulignait Florence Lefresne.
Pour elle : « le coût de l’échec scolaire est élevé et son éradication rentable à la fois pour les individus et pour la société »61, cela sans doute pas seulement dans un simple esprit de justice sociale, d’une posture humaniste mais aussi dans des intérêts bien compris des économies libérales, bien évidemment.
Mais l’écrit est aussi un levier puissant d’émancipation individuelle et collective comme l’évoquait Bertolt Brecht dansLa mère.
« Procure-toi le savoir,
Toi qui as froid !
�
Affamé, saisis-toi du livre !
�
Le livre est une arme,
�
Tu dois prendre la tête,
�
N’aie pas peur de poser des questions !
�
Ne t’en laisse pas compter, camarade !
�
Regarde toi-même,
�
Ce que tu ne sais pas toi-même
Tu ne le sais pas ! »
Par ailleurs, prétendre à une conclusion définitive sur pédagogie, illettrisme et analphabétisme serait vain. Tous les jours les pédagogues travaillent et inventent de nouvelles « ruses » et créent de nouveaux outils ; tous les jours les populations sujettes à des difficultés avec l’écrit changent, progressent, acquièrent de manière informelle ou non des savoirs et des compétences…
Au reste – c’était le but de ce texte – il s’agissait grâce à un détour par une forme d’archéologie textuelle de montrer que toutes les questions et tous les problèmes évoqués ici, et qui font encore actualité, le furent depuis longtemps. Mais que, malgré les efforts de tous et la conscience claire des enjeux, les situations d’insécurité langagière et technologique voire culturelle sont toujours aussi présentes.
Des milliers de jeunes décrochent ou sont décrochés très jeunes du système scolaire, les situations sociales et professionnelles n’œuvrent pas assez contre la récurrence et l’illectronisme menace une part significative de la population.
�
Annexe :
�
« L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples. Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d’autres compétences de base comme la communication orale, le raisonnement logique, la compréhension et l’utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans l’espace et dans le temps, etc.
Malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme ont acquis de l’expérience, une culture et un capital de compétences en ne s’appuyant pas ou peu sur la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s’intégrer à la vie sociale et professionnelle, mais l’équilibre est fragile, et le risque de marginalisation permanent. D’autres se trouvent dans des situations d’exclusion où l’illettrisme se conjugue avec d’autres facteurs ».ANLCI, 2003.
Hugues Lenoir
Enseignant chercheur émérite, Université Paris-Nanterre
Lisec EA 2310
1 Noiriel G., 2020,Une histoire populaire de la France, Marseille, Agone, 2e édition, p. 17.
2 Avanzini G., 1992, Introduction aux sciences de l’éducation, Toulouse, Privat, p. 164.
3 Voir annexe.
4 OCDE, 1997,Littératie et société du savoir, OCDE, Paris, 1997, p. 14.
5 Ibid., p. 19 souligné par moi.
6 Se reporter à Lenoir H., 2020,Repères et Réflexions sur l’écrit, Analphabétisme, illettrisme, allettrisme, Revue Initiales.
7 Abdel Sayed E., 2008,Pratiques culturelles des personnes en situation d’illettrisme TransFormations n° 1.
8 Dabène M,Le monde de l’écrit : pratiques et représentationsin Poueyto J.-L., (éd.), 2001,Illettrisme et cultures, Paris, L’Harmattan, p. 52.
9 OCDE, 1999,Surmonter l’exclusion grâce à l’apprentissage des adultes, Paris, OCDE, p. 84.
10 OCDE, 1997, op. cit., p. 74.
11 ArticleinPalazzeschi Y., 1998,Introduction à une sociologie de la formation, les pratiques constituantes et les modèles, tome 2, Paris, L’Harmattan, p. 67.
12 Clot Y., 1995,Le travail sans l’homme, Paris, Ed. La Découverte, p. 58.
13 Lemoine Claude,Former des adultes en difficultés, Entreprises formation, N° 143, mai-juin 2004.
14 Bourgeois E., 1996, (éd.), L’adulte en formation, Bruxelles, De Boeck, p. 152.
15 OCDE, 1999, op. cit., p. 43.
16 OCDE, 2000,Comment financer l’apprentissage à vie ? Paris, OCDE, p. 63
17 Bref, n° 209, Céreq, juin 2004.
18 Lemoine, 2004, op. cit.
19 Mesnier P.-M.,Entreprendre et chercher, facteurs constitutifs des apprentissages adultes,inBourgeois E., op. cit., p. 61.
20 Dartois C.,in Collectif, 2000,Former les publics peu qualifiés, Ministère de l’emploi et de la solidarité, La Documentation française, Paris, p. 20. En gras dans le texte.
21 Charlot B., Bautier E., Rochex J.-Y., 1992,Ecole et savoir dans les banlieues et ailleurs,Paris, Armand Colin, pp. 32-33.
22 Ibid., p. 66. En italiques dans le texte.
23 Knowles M., 1990, L’Apprenant Adulte, vers un nouvel art de la formation, Paris, Ed. d’Organisation, p. 44
24 Pastré P., 1998,l’analyse des compétences en didactique professionnelle, AECSE, p. 8.En gras dans le texte.
25 Sorel M., 1997,Générer de la modification cognitive : un objectif pour le formateur-médiateur, actes colloqueApprendre à apprendre : un enjeu face à l’exclusion sociale, CAFOC-IUFM de Reims, CRDP de Champagne-Ardenne, p. 66.
26 Hatchuel A., Weil B., 1997La dynamique des savoirs dans les transformations industrielles contemporaines, Educations, n° 13, pp. 59-60.
27 Sabin G.,L’Education populaire comme expérience émancipatrice en Argentine inLe Bon F., Lescure (de) E., dir., 2016,L’Education populaire au tournant du XXIe siècle, Vulnaire-sur-Seine, Ed. du Croquant, p. 145.
28 Favereau cité par Foray D. (2000),L’économie de la connaissance, Paris, La Découverte, p. 109.
29 Even N.,Deux jours en APP : Le témoignage de Valérie, apprenante inQuénelle B., 2003,La lutte contre le déficit de productivité des Britanniques, Entreprises et Carrières, n° 673, p. 82.
30 Ibid., pp. 82-83. Italiques dans le texte.
31 Abdel Sayed E., 2008, op. cit., p. 155.
32 Se reporter à son articleQuelques propos politiques sur l’éducation expérientielle in Education permanente, n° 100-101, 1989.
33 OCDE, 1997, op. cit., p. 93.
34 OCDE, 1999, op. cit., p. 23.
35 Bélisle C., 2002,La formation ouverte et à distance à l’heure du numérique, Actualité de la formation permanente, n° 180, p. 48.
36 Lenoir H., 2006,Mesures d’impact des dispositifs de formation, Université de Nanterre, p. 96
37 Bref, n° 194, Céreq, février 2003.
38 Hanouz S., 2002,Motivation et gestion de la relation pédagogique en alphabétisation, Mémoire de DESS, Paris X, p. 61. En gras dans le texte.
39 Ouzoulias A., préfaceinDe Keyzer D. (dir.), 1999,Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, Paris, Retz,
p. 7.
40 OCDE, 1999, op. cit., p. 26-27.
41 Authier M.,Eclaircissement sur quelques fondamentaux des arbres de connaissances inTessier Josiane (éd.), 1998Arbres de connaissances, controverses, expériences, Céreq, document n° 136, p. 30.
42 Bélisle C. 2002, op. cit., p. 29.
43 Battaglia,Regards d’usagers sur l’enseignement à distance, questions autour de l’autonomie des apprentissages in Glickman V. (éd.), 2000, Formations ouvertes à distance : le point de vue des usagers, INRP, Paris, pp. 53 et 54.
44 Insee première, n° 1780, octobre 2019.
45 Legros D. et Maître de Pembroke E.,Bilan et perspectives in Legros D, Crinon J., 2002,Psychologie des apprentissages multimédia, Paris, A. Colin., pp. 186-187.
46 Autoroutes de l’information et multimédia : enjeux sur le travail, les métiers et la formation, Flash Formation Continue, Cuidep, n° 421, 15 mars 1996, p. 7.
47 Crinon J.,Apprendre à écrire inLegros D, Crinoent mobilin J., 2002, op. cit., pp. 108, 110, 114, 117.
48 Voir aussi Lenoir H. et Crespin C, 1998,Illettrisme, représentations et formation dans la Fonction publique territoriale, programme de recherche du GPLI.
49Lenoir H., 2002,Adultes en situations d’illettrisme et formateurs : rapports aux technologies (représentations, discours et usages), Nanterre, Université Paris X, p. 31.
50 Lenoir, 2002, op. cit., p. 31 et sq.
51 Pour quelques données, voir mon rapport d’évaluation, Projets artistiques et culturels et acquisitions langagières, Ministère de la culture/DGLFLF, février 2021 en ligne sur le site�:https://www.culture.gouv.fr
52 Malglaive G., 1990,Enseigner à des adultes, Paris, PUF, p. 264.
53 Dumont J.-F., coord., Le Douaron P, dir, 2006. Premiers éclairages sur la réforme de la formation professionnelle, DGEFP, p. 37.
54 Garon S., Bélisle R.,La valorisation des acquis d’adultes sans diplômes secondaires : entre proposition de reconnaissance et risque de mépris inBélisle Rachel, Boutinet J.-P., 2009, dir.,Demandes de reconnaissance et validation d’acquis de l’expérience, Québec, Presse universitaire Laval, pp. 104 et 117
55 Lenoir H., 2018,Coup de pouce, une recherche-action coopérative, Association Par chemin, Conseil départemental de la Nièvre, pp. 68 et 108.
56 Saphire, 2010,Precious, Paris, Ed. de l’Olivier et Ed. du Seuil, p. 53.
57 Ibid., p. 67
58 Lahire B., 1999,L’invention de l’illettrisme, Paris, Editions La Découverte, p. 172.
59 Torunczyk Anne, 2000,L’apprentissage de l’écrit chez les adultes, cheminements du savoir lire-écrire, Paris, L’Harmattan, pp. 27 et 29. Italiques dans le texte.
60 Brady Joan, 1994,L’enfant loué, Paris, Plon, p. 158.
61 Lefresne F., 2005,Les jeunes non qualifiés, La documentation française, Problèmes politiques et sociaux, n° 915, p. 10.