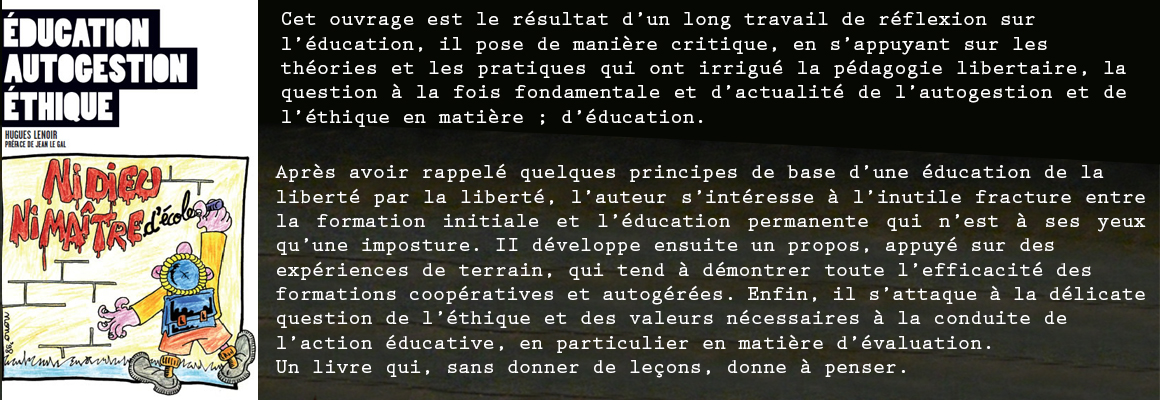“Illettrisme entre réalité et préjugés”
Hugues LENOIR
L’illettrisme est avant tout une construction sociale[1], elle a été d’abord une succession, voire une accumulation, de représentations plus ou moins pertinentes, plus ou moins construites, plus ou moins “idéologisées”. Depuis quelques années certains acteurs de terrain et quelques chercheurs tentent de percevoir dans sa diversité un phénomène social complexe et évolutif. Parler aujourd’hui d’adultes en situation d’illettrisme n’est pas en parler comme hier et encore moins comme demain compte tenu des évolutions constantes et rapides des savoirs nécessaires à l’autonomie sociale, à la maîtrise des situations de travail, à l’utilisation des technologies de l’information. Aborder la question des situations d’illettrisme aujourd’hui n’a de sens que si ce discours est contextualisé, toujours relatif et distancié. L’illettrisme n’est pas un concept unifié mais plutôt un paradigme en construction qui relève d’un travail pluridisciplinaire et pluri-acteurs où se dynamisent et se renforcent, tout en se respectant, les approches croisées des sciences humaines et sociales.
Ce sont quelques-unes des ces approches que je tenterai de pointer et de rapidement expliciter dans cette conférence.
La question de l’illettrisme, de sa définition, de sa quantification, de ses catégorisations résulte d’un malaise assez récent dans les sociétés industrialisées, qu’elles soient nord-américaine, britannique, française et quelques autres encore… Elle découle, particulièrement dans l’hexagone, du constat et des effets de la rupture du contrat social tacite hérité de la reconstruction et des trente glorieuses. Les différentes approches de l’illettrisme peuvent se lire chronologiquement au fur et à mesure que le discours, sur cet objet social encore mal identifié, se construit. La première de ces approches date des années 1970, je l’appelle l’approche quart-mondiste car elle associe illettrisme à misère et exclusion sociale radicale. Cette approche due aux militants du quart-monde visait à une compréhension et à une émergence sur la scène publique, à une “médiatisation” dirait-on aujourd’hui, d’un fait de marginalisation sociale dont l’une des caractéristiques marquantes, dans la France héritière de Jules Ferry, était l’absence ou plutôt la modestie des savoirs de base et en particulier des actes de lecture et d’écriture. Elle permit de faire apparaître alors les oubliés de la croissance, les “hors contrat”.
Dans cette approche quart-mondiste et pour simplifier, on était illettré parce qu’on était pauvre, parce qu’on naissait pauvre et on était pauvre parce qu’on était illettré. Il y avait un lien mécanique qu’on ne retrouve pas quand on connaît la réalité du terrain et que l’on côtoie des adultes en situation d’illettrisme. De plus, cette analyse déterministe réductrice niait tout parcours singulier, rendait inopérante toute tentative de salut hors l’intervention “sociale”. Cette population existe, certes et il n’est pas question de la nier, mais elle n’est pas à mon sens représentative du phénomène social nommé souvent un peu rapidement illettrisme qui est, je le souligne encore une fois, complexe et diffus. Cette vision misérabilisme fortement idéologisée était liée à une approche messianique et militante qui a permis de faire surgir et de faire prendre conscience à la société tout entière, qu’une partie de la population vivait dans des bidonvilles, ce qui était relativement bien accepté, et qu’à l’intérieur de ces bidonvilles il n’y avait pas que des travailleurs issus des anciennes colonies mais qu’ils étaient aussi natifs d’Aubervilliers, de Noisy-le-Grand, de la banlieue lyonnaise ou d’ailleurs depuis deux, trois générations. Ce constat a fait apparaître, et c’est son mérite, qu’une partie de la population hexagonale était dans la même situation que des travailleurs immigrés qui étaient arrivés dépourvus des savoirs de base – requis aujourd’hui dans la société post-industrielle – mais suffisamment solides et tenant suffisamment le feu et le bruit pour servir dans la métallurgie, la sidérurgie ou encore dans l’automobile. Savoirs de base relatifs aux cultures, étroitement articulés aux exigences socio-techniques et plus ou moins nécessaires selon les lieux et les époques. Savoirs de base dont on n’eut pas toujours besoin pour être considéré comme un bon ouvrier – industriel ou agricole – socialement inséré.
Dans la même période l’invention de l’illettrisme participera d’une distinction entre ceux qui relèvent de l’analphabétisme – qui souvent arrivent d’ailleurs – et ceux qui relèvent de l’illettrisme qui sont natifs de la périphérie et quelquefois du cœur de certaines grandes villes dont les centres se sont à l’époque largement dépréciés[2]. Ce distinguo là, je vous renvoie à la lecture de l’invention de l’illettrisme de Bernard Lahire, est à interroger car il introduit une césure, peut-être innocente mais pas totalement neutre du point de vue des valeurs et surtout des effets qu’elle peut induire, dans la compréhension et dans l’intervention pédagogique et sociale auprès de ces différentes catégories de populations.
La seconde approche, un peu plus tardive, est une approche que je qualifie d’une approche “par le manque”, approche par ce qu’ils (les illettrés[3]) n’ont pas ou parce qu’ils ne sont pas – au regard d’une normalité jamais clairement énoncée et toujours clivante -, et là sans doute la psychologie ou plutôt certaines explications psychologisantes, ont une part de responsabilité. On aborde ici l’illettrisme par le handicap social et le handicap individuel surtout, en associant la situation d’illettrisme à une situation souvent proche de la maladie, de la carence cognitive et/ou fonctionnelle, de la débilité légère.
Les sujets en situation d’illettrisme apparaissent alors – et cette représentation simplificatrice s’imposera malheureusement souvent – comme des gens malades ou quasi malades qui relèvent de déficience, qui sont intellectuellement défavorisés. Cette lecture du phénomène illettrisme ne tient plus, car si des cas relevant de déficiences psychologiques existent, ils ne semblent pas dépasser quelques pour cents parmi plusieurs millions d’individus concernés par la maîtrise imparfaite des savoirs de base. Une autre clé de lecture s’imposait donc pour tenter d’expliciter un fait social aussi massif.
L’explication “sociologique” intervient alors sans rejeter l’explication par “le manque” mais souvent en la renforçant. Elle postulait que non seulement cette population relevait éventuellement de déficiences intellectuelles, mais surtout qu’elle entretenait avec un certain nombre d’objets et de lieux des liens négatifs. En particulier, cette population possèderait un rapport négatif à la culture et au savoir. Elle entretiendrait un rapport conflictuel ou lointain avec le livre et/ou avec la scolarité. Autant de lectures réductionnistes, que j’évoque ici de manière caricaturale, mais qui obérèrent pour une large part une compréhension des réalités multiples et complexes de l’illettrisme dont les déterminants sont fort souvent socio-individuels.
A observer ces populations par et pour ce qu’elles ne sont pas – mais que certains auraient peut-être souhaité qu’elles soient pour enterrer le débat – cette approche sociologique primaire a renforcé ce que d’autres avaient contribué à fabriquer. Ce qui est plus inquiétant dans cette dimension “illettrisme-maladie”, “illettrisme-handicap”, voire maladie relevant de quelque chose que se rapproche de savoirs psychologiques, c’est qu’un linguiste de ce pays s’est autorisé dans le “Monde de l’Éducation“[4] – quand cette représentation erronée et stigmatisante de l’illettrisme maladie sociale commençait à s’éroder – à la relancer en parlant d’autisme social à propos des populations en situation d’illettrisme et où abondamment il écrivait que non seulement les “illettrés” relevaient de l’autisme social, mais de plus qu’ils étaient honteux, violents, voire délinquants. Les représentations ont la vie dures, mêmes chez les intellectuels. Le danger des constructions savantes approximatives est connu et s’offre à toutes les dérives car il transforme des observations non avérées en savoir “savant” et leur donne valeur d’argument d’autorité. De tels propos démontrent, s’il en était besoin, l’importance d’un travail scientifique essentiel à la compréhension d’une réalité complexe, socialement et surtout humainement délicate.
Je suis très courroucé que de tels inexactitudes puissent encore être diffusées, car même si un certain nombre d’entre nous avons répondu à cet universitaire[5], qu’un intellectuel français reconnu participe de cette construction sigmatisante et non fondée de population qu’il est supposé connaître – puisqu’il travaille avec elles depuis plusieurs années maintenant – est pour le moins inquiétant.
L’intérêt de ces premières approches et de leurs limites, c’est qu’elles nous ont quand même obligé à un moment donné à nous poser la question : quels sont les causes et/ou les origines des situations d’illettrisme ? Elles ont incité, face à des explications insatisfaisantes ou partielles, à oser faire des liens avec une réalité socio-économique plus large dans laquelle et avec laquelle il convenait d’interroger la question de l’illettrisme.
Grâce à cette réflexion et à cette ouverture au monde socio-économique, sur laquelle je reviendrai, il sera possible de dépasser le lien mécanique et simplificateur entre illettrisme et exclusion – marginalisation. Il apparaîtra alors qu’un groupe social beaucoup plus large que celui des exclus et des marginaux, malgré la difficulté de toute quantification, relève quelquefois de cette catégorie “illettrisme”.
Mais avant, j’aimerais évoquer quelques cas de résistance à la lettre ou à des codes hexogènes mis en lumière depuis quelques temps déjà. Formes de résistance individuelle ou groupale qui militent en faveur d’une nécessaire approche croisée des sciences humaines et sociales si l’on souhaite mieux comprendre la réalité des illettrismes. Sans pour autant exclure des causes qui sont là aussi tout à fait intéressantes et réelles, qui relèvent soit de la psychologie soit de la sociologie, la notion de résistance me semble éclairante.
Ce sont alors des groupes réfractaires à l’écrit pour des raisons culturelles qui surgissent et qui autorisent à de nouvelles compréhension. Au-delà, de la difficulté individuelle ou sociale, se manifestent des résistances collectives à un code issu d’un groupe dominant et imposé de l’extérieur. Cette attitude est particulièrement sensible chez les gens du voyage et chez les mariniers[6] qui considèrent qu’il peut y avoir danger à accepter des pratiques langagières ou scripturales “étrangères”. L’acculturation qu’elles entraîneraient pourrait avoir des effets sur les modes d’organisation, sur les fonctionnements sociétaux, sur les rapports interindividuels… L’usage de la langue et du code de l’autre, surtout lorsqu’il est dominant et même s’il n’est pas hostile, n’est pas indifférent, y avoir recours, sans réflexion préalable, peut avoir des conséquences culturelles fortes. Les ethnologues l’ont depuis longtemps constaté. Donc ces groupes malgré tout, consciemment ou non, demeurent “résistants” face à des codes que l’on se doit de maîtriser et d’utiliser dans les sociétés qui les accueillent (ou les tolèrent) et dans lesquelles ils vivent.
Georges Marandon[7], quant à lui, a identifié des formes individuelles de résistance à un moment donné, d’un individu face “à l’école” ou au savoir institué… L’individu en refusant la lettre, non pas par incapacité, résiste [communique] soit à son environnement familial, soit à l’environnement scolaire… Émergence et manifestation d’une question, d’un problème, d’une souffrance par une attitude réfractaire… Cette résistance a pour effet qu’à un moment donné le sujet se met en situation de refus de progresser par rapport à des apprentissages fondamentaux à ses yeux souvent sur-valorisés ou symboliquement sur-investis par l’environnement contre lequel il se défend. L’intérêt sociologique de ces réfractaires à la lettre, c’est que ce ne sont pas que des enfants des couches populaires qui sont spécifiquement concernés. Cette attitude se manifeste souvent chez des enfants dont les parents exercent une profession libérale ou intellectuelle et dans des milieux où l’écrit – comme symbole d’accès à la culture – est essentiel. Ces comportements de sur-évaluation de l’écrit-culture dans des groupes sociaux très favorisés peuvent entraîner des phénomènes de résistance, voire à terme d’illettrisme, chez des individus qui d’un point de vue sociologique ne sont pas particulièrement destinées à connaître l’illettrisme ou à le transmettre. Un tel constat, même marginal, dans des groupes qui ne devraient pas “reproduire” des situations d’illettrisme et qui par certains “comportements” participent de leur production, est très intéressant. Il permet de rompre, en effet, le lien mécanique et abusif entre situation de pauvreté et situation d’illettrisme, même si cette dernière, j’en conviens volontiers, les favorisent. On retrouve alors, ces jeunes de toute origine sociale dans des stages d’insertion ou dans des classes relais où ils sont qualifiés de décrocheurs mais qui sont de fait bien plus souvent des “décrochés”.
Cette prise en compte de la résistance groupale ou individuelle renforce l’idée d’un nécessaire travail interdisciplinaire sur les questions touchant aux illettrismes. En effet, ici très concrètement, l’approche par le sujet conforte le constat de formes de résistance collective et les attitudes réfractaires collectives éclairent les manifestations d’autodéfense individuelle. Ces approches à la fois cumulatives et quelquefois contradictoires nous ont permis, à une certaine période de mieux comprendre l’illettrisme, sans exclure pour autant radicalement qu’il puisse être lié à des désordres pathologiques entraînant des déficiences mais en réservant à cette approche médicalisée de l’illettrisme sa place légitime. “L’illettrisme de masse” trouvant alors son origine dans d’autres phénomènes sociaux à extraire du mutisme général.
Reste que ce travail d’approches croisées et empiriques s’inscrivait bien comme l’a souligné Jean Hébrard dans l’émotion des classes cultivées. On s’est intéressé d’un seul coup à ces gens, comme autrefois un certain nombre de dames de charité s’intéressaient à d’autres groupes sociaux marginalisés. Il y a un sans doute des parallèles à oser entre des groupes sociaux d’autrefois dénommés autrement, et les groupes sociaux paupérisés ou en voie de paupérisation d’aujourd’hui appelés autrement, mais dont les conditions de vie, les conditions de travail et les conditions de difficultés sociales, auxquelles ils sont soumis, ressemblent diablement aux conditions d’antan. En bref, les adultes en situation d’illettrisme très volontiers “quart-mondisés” dans la presse ne seraient-ils pas, pour une part au moins d’entre eux, les pauvres d’hier, voire les travailleurs pauvres (poor workers et autres homeless) d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de toujours. Certes, la société a évolué j’en conviens mais elle a ces constantes, seules les dénominations changent, celles politiquement correcte sont de règle aujourd’hui.
Nous savons, à la suite de travaux de recherche plus récents qu’en réalité les formes d’illettrisme sont foisonnantes et que la plupart des adultes en situation d’illettrisme échappent, sauf incident de vie ou de travail, à toute identification systématique. Certains affirment même, que hormis ceux “mis en danger” par des évolutions technologiques ou d’organisation, les adultes en situation d’illettrisme non seulement sont inconnus mais développent des trésors d’ingéniosité et ne sont pas, à ce jour, en situation d’exclusion. Ce risque existe mais il n’est pas inéluctable pour peu que les organisations de travail anticipent et fassent preuve d’innovation et d’intelligence sociale. Mes propres travaux conduits dans la Fonction Publique Territoriale auprès d’ouvriers et d’employés tendent, je l’espère à le démontrer.
Pourtant, malgré les efforts consentis, une réelle critique est à porter au travail sociologique qui tend à mieux cerner ces populations. C’est que dans la plupart des cas – souvent faute de moyens – les protocoles de recherche sont étroits et les échantillons sont souvent extrêmement réduits. On a trop tendance à construire des savoirs qui demanderaient à être non seulement vérifiés à partir des échantillons plus vastes, avant toute extrapolation, et éventuellement à être régulièrement réinterrogés et vérifiés à nouveau. L’illettrisme et ses formes sont une réalité mouvante malgré sa persistance dans le temps. Toute évolution sociologique ou technologique, tout choc économique peut en modifier les contours. Je ne suis pas sûr que les premiers adultes autochtones que j’ai rencontrés en 1980 à Issy les Moulineaux et qui relevaient d’un point de vue historique de l’illettrisme aient des caractéristiques strictement identiques, du fait de l’évolution des technologies par exemple, avec ceux que l’on rencontre aujourd’hui. Ne parle-t-on pas depuis quelque temps d’illettrisme électronique ? Nos catégories les plus construites demanderaient à être régulièrement revisités puisque si la société évolue aussi vite, il n’y a pas de raison que ceux qui relèvent de l’illettrisme n’évoluent pas aussi vite que la dite société, dans un sens comme de l’autre. Des prises d’informations régulières sont essentielles, sinon la sociologie pourrait construire à terme une espèce d’idéal-type figé de l’illettré. Dans cette hypothèse, peu probable néanmoins, nous n’aurions pas beaucoup avancé sur la connaissance de ce qu’est l’illettrisme réel et sur les moyens dont on doit se doter pour éventuellement permettre à ceux qui le vivent, s’ils le désirent et le souhaitent, d’acquérir ou de ré-acquérir les savoirs de base.
Autre grande critique que l’on pourrait faire aux sociologues, c’est de trop s’intéresser au discours sur l’illettrisme – discours des experts – au détriment du discours des adultes en situation d’illettrisme. Rarement les illettrés eux-mêmes s’expriment directement sur leur situation. C’est trop fréquemment le discours des lettrés qui domine et qui donne à voir et à comprendre une situation particulière et ce groupe particulier que sont les illettrés adultes. C’est le langage des savants, c’est le langage ou la vision des formateurs, celui des travailleurs sociaux, celui éventuellement d’un certain nombre de responsables d’entreprises, celui de la hiérarchie…. Ces langages alimentent l’image que nous avons aujourd’hui de l’illettrisme, de ce qu’il implique, ils imposent une image construite de l’extérieur. Les travaux que j’ai entrepris essayent de faire entendre l’illettrisme autrement. Il faut, à mon sens, pour mieux percevoir l’illettrisme, tenter de l’aborder “du dedans”, de travailler avec ces groupes d’adultes en situation d’illettrisme pour qu’ils énoncent eux-mêmes leurs réalités de l’illettrisme. En bref, il s’agit d’œuvrer à déconstruire (ou à consolider) les représentations “savantes” de l’illettrisme, trop souvent élaborées dans une position d’extériorité ethnologique.
Autre mode de compréhension de la réalité de l’illettrisme, là aussi les sociologues y ont œuvré mais aussi les historiens, c’est l’approche par la citoyenneté. Les travaux sont beaucoup trop rares. On a peu de données sur l’implication ou non de ces populations dans les activités sociales. D’après mes observations, dans un certain nombre de lieux, il y a quelques citoyens relevant de l’illettrisme qui sont fortement engagés sur le terrain social ou syndical. La question de la citoyenneté est vraiment posée mais là aussi nous sommes extrêmement pauvres en données fiables quant à la capacité ou non de ces individus à s’engager socialement. Leur compréhension du social, leur capacité d’engagement et d’action sont-elles obérées par l’illettrisme ? Sont-ils des acteurs sociaux moins actifs que ceux et celles qui sont réputés lettrés ? Rien n’est moins sûr lorsqu’on observe la faible militance et le peu d’engagement collectif de la population en général. Cette question mériterait à elle seule l’ouverture d’un grand chantier.
Ce qu’ont mis aussi à jour les travaux sociologiques parmi d’autres, dont des observations empiriques, c’est que les adultes en situation d’illettrisme ont des systèmes de contournement qui justement leur évitent d’avoir recours à la lecture et à l’écriture pour résoudre des situations sociales relativement complexes avec lesquelles ils se débrouillent plutôt bien. Ce qui les fait apparaître en tant qu’illettrés, c’est lorsque l’environnement change, quand une situation est modifiée. A partir de ce moment là, ils pourront se révéler ou être identifiés en situation d’illettrisme. C’est souvent l’inattendu, qui implique de nouvelles maîtrises, qui est révélateur d’illettrisme. Pendant très longtemps dans leur vie, il est extrêmement difficile de pouvoir identifier ces personnes comme telles. C’est le changement, du travail, de technologie, de parcours, de management qui font surgir des difficultés qui n’apparaissaient pas antérieurement.
Donc, là aussi, beaucoup de prudence. Nous connaissons beaucoup d’adultes dans cette situation, parce qu’ils se sont donnés à voir ou parce que des situations les ont donnés à voir. Il y a toute une partie de la population en délicatesse avec les savoirs de base qui aujourd’hui, à mon sens, est encore très largement inconnue. Nous serions très surpris de constater quels sont ceux qui relève ou qui ne relève pas de différentes catégories d’illettrisme.
J’en reviens maintenant à la tentative de compréhension de l’illettrisme par l’entrée socio-économique. Cette dernière approche l’aborde par l’emploi, le chômage et la qualification voire pour les modernistes par la compétence. Les évolutions technologiques, la réorganisation économique, et le chômage de masse qu’elles déclenchèrent, furent les grands révélateurs de l’illettrisme adulte. Les bras, la résistance au feu et aux fatigues industrielles n’étaient plus suffisants, il fallait dorénavant “penser” le travail et plus souvent qu’autrefois y lire et y écrire quelques mots. C’est bien autour du chômage que cette catégorie “illettrisme” a été largement constituée. C’est bien, parce qu’il y a eu difficulté d’emploi qu’a été créée artificiellement une césure entre ceux qui savaient et ceux qui savaient moins. Il se disait couramment dans les années 1980-1990 : il y a des gens qui ne maîtrisent pas les savoirs de base, sans qu’on sache toujours très bien ce que recouvrait cette dénomination large ni le niveau réel des savoirs à mobiliser. Le fait de ne pas maîtriser ces savoirs de base, ne permet pas d’anticiper, d’abstraire, de bien se situer dans la chaîne et le procès du travail, d’évoluer sur des machines plus complexes qui justement vont nécessiter de recourir à l’écrit voire au calcul et à la programmation pour fonctionner. C’est quand cette fracture technologique et économique s’est produite – fracture jamais pensée, jamais anticipée – qu’un certain nombre d’ouvriers de l’industrie, quelquefois des employés, se sont retrouver appartenir à un groupe en situation d’illettrisme. Depuis 25 ans qu’ils étaient dans l’entreprise personne, pas même les organisations syndicales, ne s’était préoccupé de cette situation qui visiblement était assez ancienne, parfois connue. Tant du point de vue du travail que de la “citoyenneté d’entreprise” tout le monde se satisfaisait du niveau de compétences professionnels et scolaires de ces producteurs. L’illettrisme comme bien d’autres réalités devenait, puisque émergeant, alors une catégorie, un objet social à construire.
Autour de cette compréhension de ce qui faisait naître des formes nouvelles d’exclusion du travail et des formes de chômage de longue durée, nous avons mieux perçu, mieux appréhendé une partie de ces groupes d’individus relevant aujourd’hui de l’illettrisme. Sachant que pour une part d’entre eux, ces ouvriers ou plus rarement ces employés étaient jusque-là considérés comme “spécialisés”, c’est-à-dire maîtrisant malgré tout les compétences et les savoirs incorporés nécessaires au travail industriel taylorisé. Mais les évolutions en cours et les modernisations technologiques les ont d’un seul coup déqualifiés voire disqualifiés puisqu’ils ne mobilisaient plus ou pas assez les savoirs requis par les nouvelles procédures.
Ces nouvelles formes du travail, ces exigences accrues en terme de productivité et de mobilisation de l’intelligence ont été un catalyseur d’illettrisme. Nouvelle donne qui n’a fait que révéler des situations extrêmement anciennes dont on ne s’était jamais préoccupé et que surtout l’on ne nommait pas.
A partir du moment où l’illettrisme a concerné la sphère du travail et de la production et où il ne s’agissait plus de pauvres marginalisés, la société s’est émue et quelquefois inquiétée. Lorsque des individus furent durablement mis de côté, que certains d’entre eux ne retrouvaient pas d’emploi dans des délais rapides (ou acceptables) ou que, lorsqu’ils étaient en formation, ils n’acquéraient pas toujours facilement les nouveaux éléments d’une qualification, on s’est aperçu qu’effectivement dans cette frange de demandeurs d’emploi, il y en avait qui ne maîtrisaient pas totalement les savoirs de base. Et que cette non maîtrise des savoirs premiers – que certains nommèrent illettrisme, légitimait aux yeux d’autres l’exclusion et dans un second temps un traitement social de la question en en transférant la responsabilité et les coûts sur la collectivité. Dédouanant dans le même mouvement l’entreprise des formes récurrentes de l’illettrisme.
Pour conclure, je dirai que toutes ces approches, très sommairement évoquées ici, sont à la fois riches d’enseignement et réductrices. Pour avoir des capacités de compréhension large du phénomène de l’illettrisme dans la société contemporaine, il conviendrait sans doute de les croiser plus systématiquement. La compréhension et l’entrée par l’emploi et la qualification sont une chose. Que l’on soit attaché à l’activité sociale et citoyenne des individus à l’intérieur des groupes auxquels ils appartiennent en est une autre mais qu’il est important croiser avec la première pour donner de la lisibilité (c’est l’occasion ou jamais de l’écrire) à l’illettrisme tombe sous le sens. Comme le croisement d’autres données à caractère sociologique que j’aurai pu évoquer : le type d’habitat, le type de scolarité, les parcours de vie, les systèmes de fratries, de famille éclairent notre compréhension. L’entrée par l’individu, par le sujet n’en est pas moins riche et indispensable.
Ainsi, je pense que si nous arrivions à travailler collégialement et en équipe pluri-disciplinaire sur ce terrain, par croisement d’approches cumulatives et complémentaires, nous serions en mesure de mieux cerner – et peut-être de mieux agir – cet objet diffus, confus, complexe et évolutif que l’on nomme aujourd’hui illettrisme. Une approche interdisciplinaire m’apparaît essentielle, mais une approche réellement coopérative, compréhensive et respectueuse des autres approches scientifiques. Que l’on soit psychologue clinicien, cognitiviste, psychosociologue, historien, linguiste, sociologue du travail, sociologue urbain, sociologue de l’éducation, didacticien, économiste… La communauté scientifique peut contribuer à œuvrer à des avancées significatives dans un domaine encore largement inexploré. Souvent les champs de la sociologie, mais c’est identique pour les autres disciplines, sont des champs cloisonnés. Il faut renoncer à ces cloisonnements artificiels et conjoncturels, disciplinaires et intra-disciplinaires, si l’on veut avancer sur cette question de l’illettrisme et sur quelles autres d’ailleurs dans le même temps.
Pour ma part je souhaiterai qu’à l’issue de ce propos, si vous deviez en retenir quelques éléments, surtout afin de les rediscuter et de les remettre à l’étude, c’est que :
1) L’illettrisme est un phénomène de société qui existe depuis longtemps mais sous des formes variées et des vocables variables, que l’illettrisme d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui, ni celui de demain. Il s’agit d’être attentifs à ces évolutions. D’autant que de nouvelles formes d’illettrisme – l’électronique et le technologique – se préparent peut-être déjà.
2) L’illettrisme est un fait et une réalité de masse, il ne concerne pas que quelques individus mais plusieurs millions de personnes tant dans l’hexagone qu’en dehors et qu’il n’est donc ni un objet de recherche simple, ni un objet fini. En réalité, L’illettrisme est un phénomène polymorphe, qui légitime peut-être l’emploi du pluriel.
3) La stigmatisation de ceux qui relèvent de cette catégorie parce qu’ils n’ont pas accéder à la maîtrise des savoirs de base n’est ni socialement ni scientifiquement juste et que souvent ils manifestent des formes d’intelligence encore à étudier.
4) L’illettrisme est bien un facteur d’exclusion pour un certain nombre d’individus mais que tous les illettrés ne sont pas, heureusement, exclus.
5) L’illettrisme interroge la société tout entière et plus particulièrement l’organisation du travail. Que ceux qui évoquent d’une manière un peu complaisante les organisations qualifiantes, les organisations apprenantes, relèvent le défi et qu’ils permettent à des organisations de travail anciennes de devenir apprenantes et que tout le monde puisse y apprendre, y compris les adultes en situation d’illettrisme.
Enfin, je crois qu’il a un risque aujourd’hui, celui de la banalisation d’une réalité inacceptable. Nous avons, par notre travail, solidifié, légitimé, conceptualisé le phénomène illettrisme. Nous l’avons donné à voir, nous avons participé à sa construction. Il est acquis, il est un fait avéré et quasiment considéré comme normal : il y a bien des illettrés en France. Il était utile de l’écrire en 1984 afin de sensibiliser et de faire réagir les classes cultivées. Aujourd’hui nous savons que cette réalité existe, qu’il y a des acteurs sociaux qui s’en préoccupent mais les moyens qui y sont consacrés sont extrêmement faibles. L’objet est nommé, il est banal, des professionnels s’en occupent, autant de bonnes raisons pour beaucoup ne plus s’y intéresser et de laisser faire les spécialistes.
[1] Lenoir H. (1999), L’illettrisme : un objet social et de recherche en construction, HDR, Université Paris X
[2] Lahire B. (1999), L’invention de “l’illettrisme”, Paris, La Découverte.
[3] Terme que j’ai renoncé à employer car par trop vague mais assez utilisé alors.
[4] Le Monde de l’Education, mars 1997.
[5] Si je ne cite pas le nom de cet universitaire, c’est afin de condamner la “démarche” et non l’homme.
[6] Se reporter à Fraenkel B (dir.), (1993)., Illettrismes, variations historiques et anthropologiques, Paris, Centre Georges Pompidou.
[7] Lire à ce sujet : Marandon G., Illettrisme, le retour du culturel, bulletin de psychologie n° 419, janvier-avril 1995.