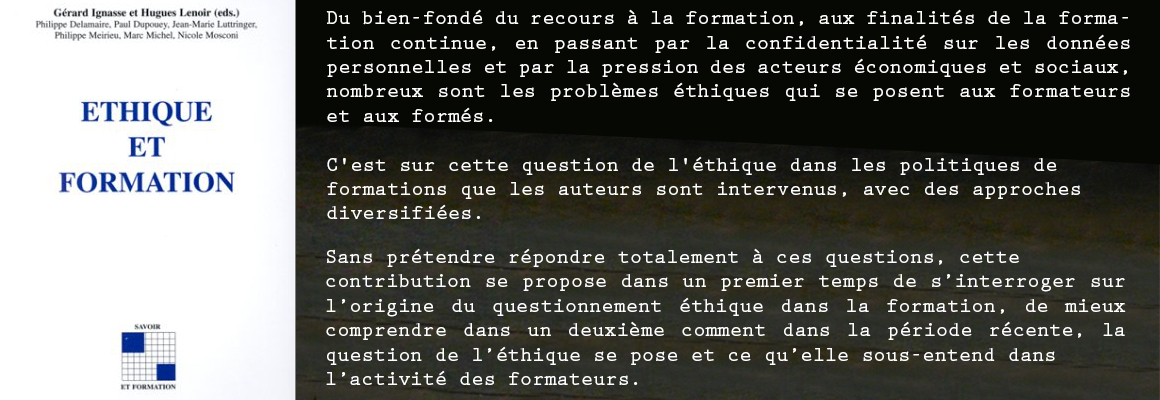Roorda
Henri Roorda pédagogue
� �
Parmi les pédagogues libertaires, on a bien oublié Henri Roorda van Eysinga (1870-1925), maître de mathématiques à Lausanne, chroniqueur et auteur du pamphlet Le Pédagogue n’aime pas les enfants. Cet article entend rappeler ses écrits sur l’école et l’enseignement, puis les discuter au prisme de leur modernité.
Henri Roorda est né à Bruxelles d’un père hollandais qui dut se réfugier en Suisse romande, à Clarens, pour avoir publié un pamphlet anticolonialiste. La maison des Roorda jouxtait celle d’Elisée Reclus, lui aussi en exil, qui eut une grande influence sur le jeune homme. Depuis 1898, Roorda, qui enseigne les mathématiques à Lausanne, publie des articles sur l’école et l’enseignement dans Les Temps nouveaux, L’Humanité nouvelle, La Revue blanche, L’École rénovée. De 1913 à 1917, il collabore au Bulletin de l’École Ferrer de Lausanne, dont il rédige entre autres les statuts programmatiques. Ses textes les plus aboutis, reprenant en partie ses premiers articles, sont Le pédagogue n’aime pas les enfants(1917), Le Débourrage de crânes est-il possible ?(1923) et Avant la grande réforme de l’an 2000 (1925), tous publiés à Lausanne.
En 1925, désillusionné, il choisit de mettre fin à sa vie, non sans avoir laissé sur sa table le manuscrit de Mon Suicide, défense et illustration du droit pour chacun de mettre fin librement à ses jours.
La vision de l’anarchiste
Critique de l’école de la soumission
Roorda s’inspire de la pensée pédagogique de Rousseau[1] et des idées d’Elisée Reclus ; il convoque aussi d’autres précurseurs dont se réclament fréquemment les pédagogues libertaires. « Rabelais, Montaigne […] et d’autres encore ont énoncé aussi, en matière de pédagogie, des vérités lumineuses. Cela n’a certes pas été inutile à tous égards. Mais, dans le monde scolaire, le progrès est d’une lenteur désespérante » [2]. Ainsi il est de ceux que l’on peut associer au courant dit des pédagogies nouvelles, toujours d’actualité et toujours si indispensables aujourd’hui pour permettre aux enfants de « faire œuvre de soi-même » (Comenius) et de devenir des « hommes fiers et libres » (Pelloutier). À plusieurs reprises, il fait allusion à Edouard Claparède qui dirige alors l’Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève.
Pour Roorda, à l’évidence, l’école est en premier lieu une école de la soumission qui n’a pour but que le dressage des individus : « Il importe peut-être, avant tout, que les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des hommes fassent très tôt l’apprentissage de la docilité [3]. » Ainsi, « l’éducation que reçoivent tous les écoliers est de nature à former des esprits obéissants, des citoyens facilement gouvernables. Le régime auquel ils sont soumis leur enlève peu à peu leur audace et leur curiosité » [4] qui sont nécessaires à un jugement libre et à la transformation sociale. L’école est donc avant tout une entreprise de normalisation, car, « c’est évident, on ne tient pas à ce que l’enfant soit intéressé par son travail. On lui demande seulement d’obéir », et, de fait, « ce qu’on demande à tous les écoliers indifféremment, c’est de ressembler le plus possible à l’Élève Modèle, lequel ne se trompe jamais » [5] car déjà conformé aux savoirs normés.
Le pire peut-être, c’est que cette école produit de la crainte et nuit au développement de l’intelligence. En effet, dès le plus jeune âge, « on a réellement fait de l’enfant le débiteur de l’école. Chaque matin, en se rendant à ses leçons, il sait qu’on pourra lui réclamer quelque chose. Et, s’il est d’une nature inquiète, il finit bientôt par vivre dans l’état d’esprit d’un coupable. Notre système pédagogique a pour effet d’enlever aux écoliers leur assurance. Il arrive à quelques-uns d’entre eux de la remplacer par de l’insolence ; mais ce n’est pas tout à fait la même chose ». De plus, et c’est un grand crime, « on n’habitue pas les écoliers à se poser des problèmes nouveaux. Inlassablement, on les met en mesure de répondre à des questions prévues » [6]. L’école apparaît donc aux yeux de Roorda comme un éteignoir de la curiosité, de l’audace et de la créativité… enfantines.
Autre critique formulée par Roorda, à la fois pédagogique et politique, à l’égard de l’école instituée, c’est de « s’intéresser beaucoup plus aux hommes du passé qui ont commandé et qui ont détruit qu’à ceux qui ont travaillé et qui ont créé ». Le lien avec la vie des humbles et le travail n’est jamais fait, et cela sans doute à dessein car « les forces conservatrices qui retardent les changements sociaux […] [et l’évolution de l’école] sont considérables ». En cela la responsabilité de l’éducateur est fortement engagée, il ne faut pas qu’il « vienne encore donner un coup de main à toutes ces puissances et mette à leur service la docilité et la crédulité des enfants » [7].
Roorda dénonce l’école comme une organisation totalitaire qui ne vise qu’à dresser autant le corps que l’esprit. « Le maître dit à ceux qui bougent : ‘Restez tranquilles !’ ou, plutôt, il articule d’une voix forte : ‘Silence dans les rangs !’ Oh, ces rangs d’une rectitude parfaite d’où, à un signal donné, vingt jambes parallèles sortent en même temps [8] ! » Quinze ans plus tard, il confirme : « C’est sans doute […] par les milliers d’heure d’immobilité qu’elle leur impose que l’école exerce sur la vie de quelques-uns de ses élèves son influence la plus profonde [9]. » Quand l’école « les a enfermés trop longtemps, elle leur prend quelque chose de plus précieux que tout ce qu’elle leur donne » [10]. En cela, écrit-il avec force, « on ne peut mieux souligner la faute irréparable que l’école commet en abrégeant notre enfance » [11].
L’école est donc bien une organisation totalitaire, une entreprise de domination et une tentative de normalisation de l’individu tout entier. Car, hormis vouloir nous apprendre à lire, à écrire et à compter, « l’école veut occuper dans notre vie une place beaucoup plus grande […]. Elle veut nous apprendre à penser ; elle veut réformer notre caractère ; elle veut nous moraliser et faire de nous des bons citoyens. Elle a même la prétention […] d’assouplir et de fortifier nos muscles : elle veut tout faire. Et cela exige beaucoup de temps, elle nous prend presque toute notre enfance ; elle nous immobilise durant des milliers d’heures dans l’attitude de l’écolier qui écoute, ou qui fait semblant » [12].
[1] L’Aminot T. (2003), « Henri Roorda, lecteur de l’Emile », Orbis Litterarum 58,et (2009) « Henri Roorda, pédagogue rousseauiste et libertaire » in Henri Roorda et l’humour zèbre.
[2] Roorda H. (1970), « Avant la grande réforme de l’an 2000 », Œuvres complètes, t. 2, p. 108.
[3] « Avant la grande réforme… », p. 163.
[4] Roorda H. (1917), Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 119.
[5] Ibid., p. 83 et p. 69.
[6] Ibid., p. 69 et p. 50.
[7] Ibid., p. 120, 127-128.
[8] « Les Effets de l’éducation moderne », La Revue blanche 28, août 1902.
[9] Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 56
[10] Idem, p. 23.
[11] « Avant la grande réforme… », p. 154.
[12] Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 22.
Pour une école de la liberté
Si Henri Roorda prononce un violent réquisitoire contre une école criminelle à ses yeux, son projet éducatif est tout imprégné des idéaux libertaires. D’abord, faire des écoles des lieux non plus de contraintes mais de liberté. Dans mon école, déclare-t-il, « l’enfant y fera peut-être (ce n’est pas sûr) plus de fautes d’orthographe qu’il n’en fait dans les écoles actuelles ; mais il y dira moins de bêtises ; il y respirera plus librement ; il y jouira d’une meilleure santé ; il y mènera une existence moins monotone ; il y sera plus actif, plus insouciant, plus heureux » [1]. En cela Roorda partage le point de vue de ses amis libertaires pour lesquels « la liberté est le couronnement de l’édifice éducatif » [2]. Idéal bafoué par les écoles autoritaires dont le but est tout autre : « C’est incontestable : nous ne faisons pas faire à nos élèves l’apprentissage de la liberté. Aussi leur faudra-t-il beaucoup de temps pour se déficeler après que nous les aurons lâchés [3]. » Au-delà de la « Liberté pour apprendre » revendiquée plus tard par Carl Rogers, Henri Roorda prône l’apprentissage coopératif, déjà présent dans la littérature anarchiste et que l’on retrouvera chez Freinet. Ainsi, écrit-il, « à l’école, les enfants pourraient s’instruire mutuellement. Mais la consigne est formelle : – Ne vous aidez pas les uns les autres ! – Collaborer, c’est tricher [4]. » La coopération est d’autant plus essentielle que, au-delà des savoirs qu’elle permet d’acquérir, elle est aussi un moyen d’éducation sociale fondamentale.
Enfin, l’école ne doit pas être coupée du monde réel et du travail. En ce sens, « il serait bon que l’école donnât à chacun de ses élèves quelque chose à aimer ; qu’elle leur révélât un noble jeu qui entretiendrait en eux, peut-être très longtemps, le goût de l’activité et de la vie » [5]. Mais, s’il convient qu’il faut donner aux enfants le goût de l’effort et de la persévérance en les apprivoisant, « il faut leur prouver que le travail n’est pas une chose aussi pénible que ça », mais qu’il serait « inepte d’assimiler son activité[celle de l’écolier]au travaildu salarié » [6]. Une autre raison d’être d’une école où l’on apprend à penser par soi-même − et là l’anarchiste Roorda apparaît bien −, c’est celle qui consisterait « à mettre les jeunes gens en garde contre la détestable éloquence des agités, des poseurs et des menteurs » [7] afin que la jeunesse échappe au charme des populistes, des démagogues et autres bellicistes. Mais un tel souhait implique une rupture forte avec l’ordre établi car, si « le rôle de l’école est d’entretenir l’idéalisme dans l’âme humaine, et, dans ce sens, son action ne peut être que révolutionnaire, qu’elle ait donc le courage de dire aux puissants défenseurs de l’ordre actuel : ‘Ne comptez plus sur moi [8] !’ » Rupture qui en toute logique conduit les anarchistes à créer des écoles libres en dehors de la sphère des Églises et des États. C’est ce que Roorda tenta avec d’autres à l’École Ferrer de Lausanne dont le but était de proposer « un enseignement fait dans l’intérêt de l’enfant et adapté au besoin de la classe ouvrière » [9].
Comme Rousseau, mais surtout comme les tenants des pédagogies nouvelles, Henri Roorda souhaite placer l’enfant au centre de ses apprentissages, d’autant qu’il faut veiller et œuvrer à ce que « la vie intellectuelle de l’écolier ne s’arrête pas quand les pédagogues cessent de s’occuper de lui » [10]. Au-delà de la pédagogie active, Roorda réaffirme l’importance d’une pédagogie inductive pour former l’intelligence et la capacité à penser et comprendre par soi-même. Ainsi, dans ce projet d’« une école meilleure », il rappelle fermement que le maître « ne sera pas pressé de communiquer à ses élèves sa propre science. Il s’en tiendra à ce principe essentiel : L’ACTIVITÉ D’ABORD ; LA FORMULE APRÈS. Durant les premières années, l’enfant ne connaîtra pas d’autres règles (de grammaire ou d’arithmétique) que celles qu’il découvrira lui-même. Et ainsi, les propositions générales qu’il énoncera auront pour lui une signification claire » [11].
Il convient, selon Roorda, de fournir aux écoliers le plus « fréquemment l’occasion d’être actifs […] ils seraient moins impatients (de quitter l’école) si on leur donnait une occupation à laquelle ils pourraient se livrer avec ardeur » [12] et qui les intéresse. Dans son rêve de pédagogue, l’apprentissage devient un moment de bien-être, un jeu intellectuel au sens propre du terme : « J’aime la joie et je déteste la contrainte. Je ne voudrais voir dans mes leçons que des enfants confiants et joyeux, qui joueraient passionnément avec tous les problèmes [13] », y compris les savoirs les plus abstraits. Se référant explicitement à Claparède, il écrit : « Le débutant pourra aussi apprendre l’arithmétique et les premiers éléments des mathématiques en jouant [14]. » Mais, une fois encore, le constat est amer, l’école n’est faite que de routine, elle est un univers sans surprise où la lassitude gagne souvent l’apprenant. « Ce qui m’a frappé, c’est l’ordre immuable que l’école met dans sa besogne. Pour ses élèves, l’imprévu n’existe pas. Chaque semaine, les leçons se succèdent comme elles se sont succédé la semaine précédente […] et, probablement, quelques-uns d’entre eux, en se rendant au collège, savent d’avance que ce sera ennuyeux. » L’école, au lieu d’être l’occasion de l’apprentissage de l’émerveillement, car « c’est quand on est jeune qu’on s’émerveille le plus facilement devant la beauté des choses nouvelles », au lieu d’être le temps de la découverte et de la créativité, est une source de monotonie pesante où la tâche habituelle de l’écolier « est de formuler dans une langue qui n’est pas la sienne les idées des autres » [15].
Roorda propose donc de raison garder et de limiter la sédimentation pédagogique. Ainsi, si « les programmes scolaires se sont ‘développés’ à la manière de certaines pierres dont le volume augmente parce que des particules de sable viennent s’attacher à leur surface, pour les ramener à leur état primitif, il suffirait de les ‘racler’ » [16].
[1] Ibid., p. 108.
[2] Delaunay E., article « Éducation », Encyclopédie anarchiste.
[3] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 86.
[4] « Avant la grande réforme de l’an 2000 », p. 157.
[5] Ibid., p. 158.
[6] Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 110 et 112.
[7] « Le débourrage de crânes est-il possible ? », Œuvres complètes, t. 1, p. 310.
[8] Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 127.
[9] Wintsch J., Un essai d’institution ouvrière : l’École Ferrer, in(2009), L’Ecole Ferrer de Lausanne, p. 31.
[10] Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 99.
[11] Ibid., p. 93-94.
[12] « Avant la grande réforme… », p. 156 et p. 148.
[13] Ibid., p. 109.
[14] Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 96.
[15] Ibid., p. 59, 66, 72.
[16] Ibid., p. 17.
La modernité de Roorda
Une pédagogie de la recherche et de l’intelligence
Henri Roorda soulève des questions qui font encore débat aujourd’hui dans la collectivité éducative. Il pose la question du sens des apprentissages qui bien souvent sont hors de la compréhension immédiate des écoliers. Ainsi, à propos des théorèmes d’algèbre, qu’il a longtemps enseignés : « Ils n’ont de signification claire que pour les initiés. C’est dire que beaucoup d’écoliers les débitent sans y comprendre grand’chose. » Il déplore aussi l’absence d’interdisciplinarité, en particulier entre l’histoire et la géographie, peut-être en souvenir de Reclus : « la distinction que l’on fait entre ces deux enseignements n’a pourtant rien de nécessaire ; car il s’agit d’expliquer la conduite d’un peuple ou d’un individu, l’importance du milieu n’est pas moins grande que celle du moment » [1]. Dans le même mouvement, il désapprouve la culture du « par cœur » : plutôt que d’encombrer la mémoire, il préconise de mettre le savoir à disposition dans des « bureaux encyclopédiques, où les curieux trouveraient tous les renseignements qu’ils désirent » ; encore faudrait-il pour cela, ajoute-t-il, « éveiller la curiosité de l’écolier » [2]. Roorda prône de facto, pour remédier aux travers de l’école, une pédagogie de la recherche toujours d’actualité. Selon lui, « les écoliers d’aujourd’hui étudient les sciences comme ceux d’autrefois apprenaient le catéchisme » [3], c’est-à-dire sans rien en comprendre, sans recul critique, sans usage et comme une croyance irrationnelle au travers d’une culture livresque. Sur ce point, l’influence de l’auteur de l’Emile se fait jour. « Il y a un mot de Rousseau […] que je cite toujours avec plaisir, écrit-il. Rousseau dit : ‘Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. Remplacer cela par des livres, c’est nous habituer à toujours croire et à ne jamais rien savoir.’ (…) Et beaucoup trop tôt l’école instruit [les enfants] au moyen de livres. Nous serions sans doute moins bêtes si nous n’avions commencé à lire qu’à l’âge de trente ans [4]. »
Pour que se développe une véritable pédagogie de l’intelligence qui ouvre les esprits au lieu de les scléroser, bien des pratiques et bien des conceptions de l’apprentissage sont à réformer car « ce n’est pas en posant aux écoliers, pendant des années, des questions qui n’admettent qu’une seule réponse acceptable qu’on affine leur esprit […] trop souvent, dans les exercices qu’on leur propose, ils ne peuvent mettre aucune imagination, aucune invention, aucune fantaisie, et ils doivent les exécuter avec la docilité d’un manœuvre » [5]. Au-delà de la force de l’image, cette sortie de Roorda montre en quoi l’apprentissage relève davantage de l’instruction que de l’éducation, du dressage et de la soumission que de la mobilisation de l’intelligence et du raisonnement.
Une pédagogie individualisée et des représentations
Ce qui donne toute sa contemporanéité à la pensée d’Henri Roorda, mais aussi sa singularité par rapport à d’autres pédagogues libertaires, c’est son souci des individus et de leurs différences face aux apprentissages et sa mise en valeur du travail éducatif à engager pour lutter contre les représentations. Les processus cognitifs individuels ne sont pas une question qui intéresse l’éducation et les éducateurs : « l’école a le tort de s’intéresser davantage à ce qu’ont fait les savants qu’à ce qui se passe dans la tête de l’ignorant [6]. » Cette école méritocratique élimine, sans autre forme de procès, les individus les moins talentueux et jamais elle ne se demande pour les « médiocrement doués : […] quelles étaient leurs aptitudes véritables ? […] Or, tous les enfants ne se développent pas de la même façon ; ils ne peuvent pas progresser tous de la même allure » [7]. Il convient donc d’adapter le rythme des apprentissages au rythme de chaque enfant et non pas d’imposer une allure commune au nom d’une pseudo-égalité de traitement. Les élèves « assimilent tous (plus ou moins bien) la même somme de connaissances. Ceux qui ont de la facilité et ceux qui n’en ont pas doivent ‘progresser’ avec la même vitesse. J’ai donc le droit de dire qu’on se soucie assez peu de la qualité du travail qui se fait dans l’esprit de l’écolier […]. L’école […], telle que je la conçois, fournira à chaque enfant l’occasion d’améliorer ce que la nature lui a donné de bon ». Elle tiendra donc compte des différences qu’il y a entre les individus et elle ne sera pas « égalitaire » [8].
Autre élément de modernité chez Roorda, c’est son souci constant de traquer les représentations erronées et les savoirs approximatifs. « Étiqueter, classer, juger des êtres et des choses que l’on n’a jamais étudiés avec soin, des êtres et des choses que l’on ne connaît pas ; voilà l’habitude que l’on contracte à l’école et que l’on gardera peut-être jusqu’à la fin. [9] » De fait « l’école habitue l’enfant à se payer de mots […]. En obligeant les enfants qui ne savent rien de la vie à porter des jugements sur les institutions et sur les hommes du passé, on les rend ridicules » [10] et porteurs de représentations sur lesquelles, en toute bonne foi, ils construiront leurs jugements et leurs actions ultérieures. Le débourrage de crânes est donc une œuvre de santé publique et une nécessité sociale.
Il convient donc, pour sortir de la caverne, d’apprendre à opérer un retour réflexif sur nos apprentissages et de toujours se demander : « Voyons ! Avons-nous eu le temps de pensertout cela ? Nous a-t-on enseigné des notions justes, ou bien d’effroyables inepties [11] ? » L’école demeure le lieu des savoirs superficiels, le lieu d’un décodage partiel où le fond n’est que trop rarement abordé, où la compréhension n’est que secondaire : « on s’applique bien plus à faire réciter (aux écoliers) ce qu’ils ont lu qu’à les mettre en garde contre le pouvoir trompeur des mots » [12]. Mais cette critique, Roorda n’est pas dupe, ne s’applique pas qu’aux savoirs scolaires et il sait que dans son propre milieu, où l’autodidaxie et la recherche de la science de son malheur sont la règle, de telles erreurs peuvent aussi se produire : « Quant au révolutionnaire intransigeant qui n’a cherché la vérité que dans les journaux anarchistes, il ressemble beaucoup, par la pauvreté de ses conceptions, au petit rentier qu’il méprise [13]. »
L’école doit donc être exigeante avec ses élèves, leur fournir les moyens d’une pensée critique et les sensibiliser à la démarche scientifique. Il faut leur faire « comprendre que les problèmes qui nous passionnent sont d’une complexité inouïe et que nos hypothèses et nos opinons ne sont pas des vérités établies » [14], qu’elles sont toujours interrogeables et souvent dépassables. Henri Roorda est en cela en plein accord avec Francisco Ferrer qui écrivait dans L’École moderne : « Nous ne craignons pas de le dire : nous voulons des hommes aptes à évoluer incessamment, capables de détruire et de rénover constamment les milieux sociaux et de se renouveler eux-mêmes, des hommes dont l’indépendance intellectuelle soit la force suprême, qui jamais ne s’assujettissent, mais toujours sont disposés à accepter toute amélioration, heureux du triomphe des idées nouvelles [15]. »
[1] Ibid., p. 29, p. 43.
[2] Ibid., p. 35.
[3] Ibid., p. 75, p. 78.
[4] « Le débourrage de crânes », p. 310.
[5] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 85, p. 80.
[6] « Avant la grande réforme… », p. 141-142.
[7] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 70 et p. 24.
[8] « Avant la grande réforme… », p. 120s.
[9] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 85.
[10] « Le débourrage de crânes », p. 311.
[11] « Le débourrage de crânes », p. 294.
[12] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 119.
[13] « Le débourrage de crânes », p. 303.
[14] Le pédagogue n’aime pas les enfants, p. 122.
[15] Cité par Heimberg C., in L’Ecole Ferrer de Lausanne, p. 22.
Une pédagogie pragmatique
L’école ne doit plus être l’école de la crainte et de l’autorité. A l’école libre qui précéda l’École Ferrer de Lausanne, « il était bon d’apprendre tout d’abord aux enfants qu’on était entre camarades, qu’il n’y aurait point de discipline et qu’on ne leur parlerait que de choses qu’ils pouvaient discuter, vérifier, rectifier » [1]. Une école qui, comme la Ruche de Sébastien Faure, se voulait « un exemple de bien-être et de joie coopérative intelligemment comprise et fraternellement pratiquée » [2] où règne un climat apaisé, moteur et facilitateur des apprentissages.
Ce que préconise aussi Roorda pour moins priver les individus de leur enfance, c’est un allègement des horaires synonymes d’immobilité et de passivité. Une école où la quatrième heure serait consacrée à l’exercice physique mais surtout où l’indispensable troisième du matin serait réservée « à la culture de l’enthousiasme » et du beau durant laquelle « les maîtres n’auront d’autre but que d’intéresser vivement, ou d’émerveiller, ou d’émouvoir leurs élèves ». Quant aux après-midi, ils serviraient au travail libre ou encore au « renforcement et au rattrapage » pour les élèves en difficulté. Chaque semaine un temps serait employé à la réalisation de travaux manuels. En cas de beau temps « on remplacera la leçon par une longue promenade dans les prés et dans les bois » et « on fera appel à toutes les personnes de bonne volonté ayant de l’enthousiasme à communiquer. Les élèves pourront proposer tout ce qu’ils voudront » [3].
Henri Roorda dénonce aussi, là encore en pionnier, la pédagogie de la faute et anticipe sur ce que d’aucuns, en la valorisant, appellent aujourd’hui une pédagogie de l’erreur. « Il semble d’ailleurs bien que son vrai rôle, à l’école, soit celui-là : faire des fautes. Ne représentent-elles pas l’ignorance et le mal ? » Cette logique culpabilisatrice a un effet pervers : « Le fait est que leurs petites mésaventures leur font vite comprendre qu’ils ont intérêt à cacher leur ignorance [4]. » Dans l’école idéale, « l’écolier n’aura rien à craindre. On commencera par le rassurer. Il ne s’exposera pas à une mauvaise note en commettant des erreurs. Il aura, comme tout le monde, le droit de se tromper » [5]. De facto, Roorda, très en avance sur les pratiques de son temps, préconise à sa manière l’évaluation formative et le renforcement positif. « On pourrait, écrit-il, leur montrer (aux écoliers) qu’ils ont acquis plus de sûreté, qu’ils sont devenus plus forts, plus habiles, plus adroits. Et cette constatation serait de nature à entretenir leur confiance [6]. »
La posture du pédagogue
Roorda considère qu’une partie de la responsabilité incombe aux éducateurs, même si la tâche est difficile. D’une part, parce que l’usure intellectuelle, l’ennui et la répétition menacent, et à l’évidence « il vaudrait toujours mieux que le maître fût lui-même intéressé par les choses dont il parle » [7]. D’autre part, un trop-plein de certitudes sur son rôle et son savoir peut le conduire à ne plus s’interroger, à ne plus se remettre en question car « le pédagogue, s’il ne se surveille pas, jouit d’une trop grande sécurité intellectuelle » [8] et risque, à terme, de ne plus considérer l’intérêt de l’enfant. Même si certains élèves font de la résistance, et s’il n’est pas facile de « se laisser arrêter sans irritation par un gamin qui ne veut pas connaître la Vérité » [9]. Enfin, Roorda stigmatise le travail de reproduction sociale et de clonage auquel participent les éducateurs : « les pédagogues, inconsciemment, sont portés à donner les meilleurs rangs aux élèves qu’ils jugent dignes de leur succéder » [10].
En réalité, c’est le maître lui-même et la pédagogie qu’il utilise qui créent son propre ennui. Pour Roorda, « le malheur des maîtres est de ne jamais trouver parmi leurs élèves un contradicteur ayant de l’autorité[…] ah ! Comme notre besogne pourrait être passionnante si nos élèves avaient de la curiosité, de l’avidité ! » [11] Les maîtres, quoi qu’ils en pensent, sont les artisans de leur mésaventure. « Le premier devoir du maître sera d’être bienveillant [12] ». De ce conseil se décline la posture du pédagogue libertaire. Tout d’abord, celui-ci doit renoncer à l’usage de la pédagogie frontale et expositive, apprendre « à s’abstenir et à se taire [13] » pour laisser place à la parole et à l’initiative des enfants, car « il y a trop de conférenciers parmi les pédagogues de notre époque […] et trop souvent [le rôle des écoliers] se réduit à celui de figurants dont les professeurs ont besoin pour faire leurs cours » [14]. Mais, pour cela, il faut que les mœurs évoluent : « quand on attachera moins de prix à la docilité intellectuelle des écoliers, on leur donnera plus d’entraîneurs et moins de professeurs » [15]. C’est la posture du facilitateur que développeront Carl Rogers et Malcolm Knowles [16]. Tel aurait été d’ailleurs le désir de Roorda : « J’étais fait pour être l’entraîneur de mes élèves, et non pas leur maître [17]. »
Posture du facilitateur qui renonce aux discours savants, qui met tout son talent au repérage et à la mise à disposition des ressources pédagogiques les plus diverses et qui se considère comme une ressource parmi d’autres afin de favoriser chez les apprenants une vraie dynamique d’apprentissage. Voilà pourquoi, écrit Roorda, « dans mon école, le maître n’aidera ses élèves que lorsqu’ils le lui demanderont ; et il s’ingéniera de toutes les manières à entretenir leur persévérance et leur confiance […]. Voilà pourquoi, dans mon école […], le maître emploiera tous les moyens […] pour accroître le désir de savoir, d’entreprendre, de créer » [18]. En d’autres termes, l’école serait tout autre et son « rendement serait meilleur » si le maître, « au lieu de travailler contre l’enfant, le maître travaillait aveclui, si le maître était plus souvent un entraîneur et moins souvent un juge » [19].
Ainsi, Henri Roorda, en interrogeant la posture de l’enseignant, s’inscrit dans la tradition des pédagogues anarchistes où l’éducateur n’est plus « un tyran détesté » [20] mais un « maître-camarade » [21] et se pose aussi, à sa manière, en devancier de ceux qui en leur temps conceptualiseront la non-directivité et l’autogestion pédagogique.
[1] « Rapport sur l’école libre de Lausanne », L’Ère Nouvelle, Paris 1906.
[2] Cité par Raynaud, J.-M. (1987), T’are ta gueule à la révo,p. 222.
[3] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 100, p. 102-106.
[4] Ibid., p. 82 et p. 64.
[5] Ibid., p. 96.
[6] Ibid., p. 66-67.
[7] « Avant la grande réforme… », p. 144.
[8] Ibid., p.112.
[9] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 38.
[10] Ibid., p. 41.
[11] Ibid., p. 40 et p. 90.
[12] Ibid.,p. 97.
[13] Ibid., p. 99.
[14] « Avant la grande réforme… », p. 123 et p. 124.
[15] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 42.
[16] Knowles M. (1990), L’Apprenant adulte, p. 189-192.
[17] « Avant la grande réforme… », p. 109.
[18] Le pédagogue n’aime pas les enfants,p. 100s.
[19] « Avant la grande réforme… », p. 143.
[20] Guillaume J. cité par Raynaud J.-M., op. cit., p. 207.
[21] Schmid J.-R. (1936), Le Maître-camarade et la pédagogie libertaire.
Conclusion.
Un pessimisme pédagogique bien tempéré
�
Sur la fin de sa vie, Henri Roorda fait montre d’un pessimisme relatif quant aux possibilités de transformer le monde à l’aide du levier émancipateur qu’est l’éducation. Est-ce un retrait par rapport à son idéal libertaire ? Rien ne le laisse supposer ; ce pessimisme est plutôt lié à une forme de lassitude qui le conduira à se suicider. La grande boucherie de 1914-1918 a entamé l’optimisme de beaucoup sur les capacités de l’éducation si ce n’est à transformer, du moins à pacifier le monde. « Pendant des années, écrit-il, j’ai dit beaucoup de mal des écoles publiques pour cette raison qu’elles soumettent leurs élèves à une discipline qui, vraisemblablement, ne les rendra pas plus intelligents. Et dans mes heures d’enthousiasme, j’ai cru que j’avais trouvé la solution générale du problème pédagogique. Mais que de choses ne faudrait-il connaître pour avoir le droit de le dire [1]. » Dans le même mouvement critique, il se questionne sur la légitimité d’un débourrage de crânes absolu qui peut-être détruirait tous les espoirs de la jeunesse et du même coup toute possibilité de progrès social, voire de révolution. En ce sens, il s’autorise à formuler une nouvelle hypothèse pédagogique : « Si les jeunes gens voyaient dans les mots : amour, famille, justice, avenir… ce qu’ils verront quarante ans plus tard, ils n’entreprendraient rien. En ‘débourrant’ les crânes, on s’expose à les vider complètement. En ôtant aux hommes leurs illusions, on mettrait fin à tout [2]. » Mais il conserve encore une lueur d’espoir : « Je compte encore un peu sur les hommes qui ne sont pas encore nés. La grande réforme que j’espère se fera peut-être en l’an 2000 [3]. » Il n’en fut rien, mais l’espoir demeure.
�
Bibliographie
Roorda H. (1969-1970), Œuvres complètes, t. 1 et t. 2, Lausanne, L’Âge d’homme.
Henri Roorda, pédagogue libertaire, chroniqueur facétieux, et l’humour zèbre (2009), catalogue d’exposition au Musée historique de Lausanne (mars-juin 2009) et actes du colloque organisé par l’Association des Amis d’Henri Roorda en mai 2008, Lausanne, MHL, Humus.
Les articles d’Henri Roorda dans L’Humanité nouvelle et dans La Revue blanchesont consultables en ligne sur gallica.bnf.fr
Bremand N. (1992), Cempuis, une expérience d’éducation libertaire à l’époque de Jules Ferry, Paris, Editions du Monde Libertaire.
Delaunay E., article « Education », Encyclopédie anarchiste, Paris, Librairie internationale.
Faure S. (1992), Ecrits pédagogiques, Paris, Editions du Monde libertaire.
Freire P. (1977), Pédagogie des opprimés, Paris, Maspero.
Houssaye J. (dir.), Quinze pédagogues, leur influence aujourd’hui, Paris, A. Colin.
Illich I. (1971), Une société sans école, Paris, Le Seuil.
Knowles M. (1990), L’Apprenant adulte, Paris, Ed. d’Organisation.
L’Aminot T., « Henri Roorda, lecteur de l’Emile », Orbis Litterarum 58,et (2009) « Henri Roorda, pédagogue rousseauiste et libertaire » in Henri Roorda et l’humour zèbre.
Lenoir H. (2008), « Georges Sorel et l’éducation », Les Temps maudits, n° 27.
Lenoir H. (2009), Eduquer pour émanciper, Paris, Editions CNT-RP.
Lenoir H. et Enckell M. (2010), Henri Roorda ou le Zèbre pédagogue, Paris, Editions libertaires (« Graine d’ananar »).
Lewin R. (1989), Sébastien Faure et la Ruche ou l’éducation libertaire, Vauchrétien, Ivan Davy éditeur.
Proudhon P.-J. (1977), De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Editions du Monde libertaire, t. 2.
Raynaud, J.-M. (1987), T’are ta gueule à la révo ! Dires et agirs d’éducations libertaires,Paris, Les Editions du Monde libertaire.
Rogers C. (1973), Liberté pour apprendre, Paris, Dunod.
Roorda H. (1918), Le pédagogue n’aime pas les enfants, Lausanne-Paris, Librairie Payot.
Schmid J.-R. (1936), Le Maître-camarade et la pédagogie libertaire, Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestlé.
Wintsch Jean, Heimberg Charles (2009), L’École Ferrer de Lausanne, Lausanne, Editions Entremonde.
[1] « Avant la grande réforme… », p. 107.
[2] « Le débourrage de crânes », p. 318.
[3] « Avant la grande réforme… », p. 116.