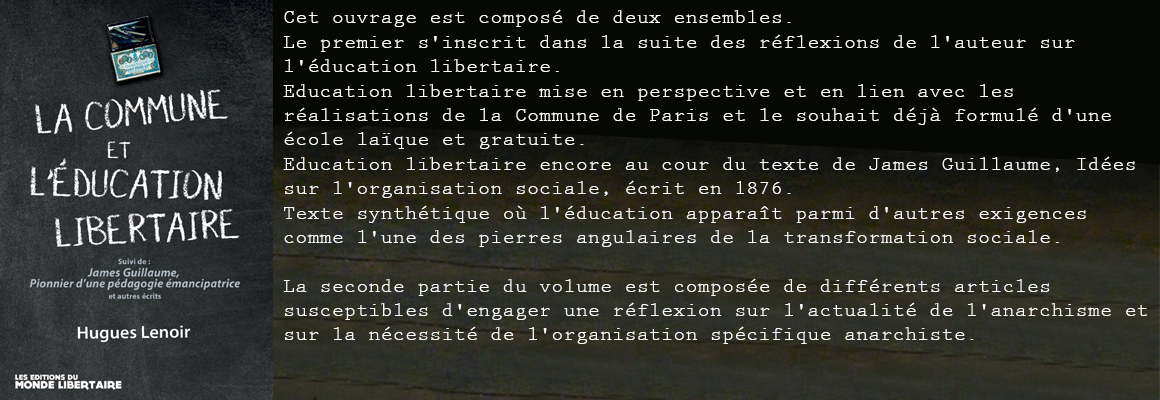L’Atelier du chercheur
Hugues LENOIR
�
�
Paradoxalement, c’est à l’issue de ma carrière de chercheur, – je suis à ce jour émérite, – que je me vois confier par l’équipe ATIP la rédaction de la postface, dans le cadre de ma post–carrière, d’un ouvrage collectif sur le métier ou plutôt les activités du chercheur dans le domaine des sciences humaines, mais pas que. Réflexion « post », il est vrai, engagée par moi depuis le symposium sur ce thème lors des rencontres de l’AREF à Montpellier en 2013 et lors de la lecture en amont de la publication de certains articles du présent ouvrage.
Dans cette postface, je ne reviendrai pas terme à terme sur son contenu et je me limiterai seulement à faire librement état de mes réactions, interrogations, suggestions, digressions, déambulations, pérégrinations à la lecture de tel ou tel de ses auteurs. Et je m’autoriserai à quelques ouvertures afin de poursuivre la recherche en cours.
Dans une première partie, j’évoquerai mes propres sources et quelques réflexions sur le métier de chercheur. Dans une seconde partie, je soulignerai ce qui à la lecture a pu confirmer certaines de mes propres constatations et convictions.
�
�
Le chercheur, un travailleur comme les autres…
C’est la position que j’ai toujours défendue, mais bien souvent de manière idéologique en me référant à l’œuvre de Pierre-Joseph Proudhon et aux propos du militant anarcho-syndicaliste Pierre Besnard qui, dans les années 1930, refusaient déjà le clivage hiérarchique entre travailleurs de l’outil et travailleurs de l’esprit. Besnard affirmait, contrairement à d’autres courants de pensée que « l’ouvrier de l’industrie ou de la terre, l’artisan de la ville ou des champs […] l’employé, le fonctionnaire, le contremaître, le technicien, le professeur, le savant, l’écrivain, l’artiste […] appartiennent à la même classe » (Besnard, 1978) : celle des travailleurs. Position étayée, pour moi, il y a déjà longtemps par la lecture du livre de Bernadette Aumont et Jean-Marie Mesnier et plus récemment par celui de Crawford sur lesquels je vais revenir.
�
Dans L’acte d’apprendre paru en 1992, Aumont et Mesnier consacrent un chapitre au travail du chercheur intitulé Le processus chercher. Où ils rappellent l’étymologie de chercher issu de cicare en latin, c’est-à-dire « faire le tour de » (p. 99, en italique dans le texte). Ce qui signifie que chercher renvoie à une action et à une circularité par rapport à un objet. Activité ayant pour conséquence directe que les dimensions du faire et du se déplacer physiquement et intellectuellement sont en effet très présentes dans le discours des chercheurs. La recherche en acte serait une circumnavigation. Le chercheur est un navigateur quelquefois sans boussole, quelquefois avec, parfois poussé par des vents favorables parfois non, sujet au grain, à la houle, aux brumes et au hasard des rencontres ou des corrélations. Toujours exposé au danger de s’échouer suite à la rencontre du récif de l’incompréhension ou d’une analyse hâtive et parfois biaisée. Tels sont les risques du métier.
Au-delà, l’approche des auteurs anticipe certains des constats faits par l’équipe ATIP. Ils utilisent l’expression le « métier de chercheur » et assimilent le travail du chercheur à une « activité de recherche » matériellement repérable. Ils affirment que « faire recherche » est à la fois un acte d’apprentissage et de production de savoir. De plus, ils convoquent l’expression « travail de recherche », ce qui renvoie bien la recherche à la conduite d’activités concrètes qui requiert un réel « travail des mains ».
Par ailleurs Aumont et Mesnier reprennent les propos de Chneiweiss, chercheur à l’INSERM, pour lequel la recherche relève d’un « bricolage » « qui permet une nouvelle expérience […]. Ce chercheur-là est [pour lui] un artisan de la connaissance » (Ibid., p. 100). Et en matière de bricolage, les auteurs ajoutent : « Le chercheur parle volontiers de son activité comme d’un « “bricolage »” qui sollicite aussi bien -– au moins dans la recherche en sciences fondamentales [mais pas que selon moi] – l’activité sensorielle et le travail des mains que l’élaboration conceptuelle » (Ibid., p. 117).
Toujours dans leur analyse du processus chercher, ils intègrent dans le métier de chercheur une dimension « collective » souvent négligée. Ils affirment à juste titre que : « le chercheur aujourd’hui est un homme de contact. La rencontre fait partie du travail de recherche comme l’expérimentation et le recueil de données : rencontres extérieures, travail d’équipe quotidien, confrontation avec la communauté scientifique » (Ibid., p. 104) à l’occasion, de lecture, de publications ou de colloques… d’où l’importance, selon moi, pour les jeunes chercheurs d’intégrer, voire de se former à la dimension psychosociale de l’activité de recherche. Autour de cette dynamique de la recherche et du travail en équipe, Aumont et Mesnier ajoutent à la suite de B. Latour l’importance des interactions sociales et de la controverse pour enrichir ou nuire au travail du chercheur et aux résultats de la recherche. Ils citent Latour : « Les relations de pouvoir, les rivalités, les affrontements idéologiques sont présents dans le métier de chercheur comme dans tous les autres, et ils y sont intégrés [ou non] comme dans tous les autres, reconnus comme sources d’intercommunications ». Sans compter la place des égos souvent pointée comme un frein à cette dimension.
Enfin, et c’est sans doute la finalité de leur propos, les auteurs confirment que « l’activité de recherche consiste en grande partie à apprendre (en défrichant un domaine de connaissance) puis à expérimenter pour s’approprier l’objet et en vérifier l’intérêt » (Ibid., p. 120)).
Et citant les propos d’un des membres de leur échantillon, ils affirment -– et je m’associe à eux ici – – qu’on peut apprendre sans chercher [l’apprentissage vicariant est en cela un bon exemple], mais chercher sans apprendre, sûrement pas ». Le métier de chercheur s’inscrit donc dans une perspective d’éducation permanente tout au long de la vie, plus ou moins régulée et consciente., dans une activité peu ou prou, comme l’écrirait certain, apprenante voire « capacitance ». AÀ la lecture du présent ouvrage, il est facile de constater que, dans leur le travail, les chercheurs du LISEC ont à leur tour pointé de nombreux éléments déjà soulevés en 1992. Résultats convergeant qui tendent bien à prouver que chercher est une activité où le faire et l’apprendre sont permanents et centraux.
�
Quant à M., B. Crawford, dans son Éloge du carburateur paru plus récemment en 2016, il relate sa propre expérience. Celle-ci conforte la thèse d’Aumont et Mesnier. Crawford soutient qu’il s’agit, pour le chercheur en activité, comme pour le mécanicien, de conduire « un travail doté de sens » dans une relative « indépendance » afin de réaliser du bel ouvrage. Un ouvrage qui, si possible, doit être socialement utile, au sens où produire du savoir sert la communauté humaine dans son ensemble. Le travail du chercheur comme celui du mécanicien repose pour lui sur une même idée : « La véritable connaissance naît d’une confrontation avec le réel » (Crawford, 2016, p. 13)). Donc d’un faire spécifique, mais incontournable, au métier exercé.
�
�
L’activité du chercheur
Cet ouvrage collectif de réflexion sur l’activité conduite par une équipe pluridisciplinaire est aussi une démarche commune de recherche de ce que nous sommes lorsque nous sommes en recherche, c’est-à-dire dans notre quotidien du travail et dans les activités qui le constituent, quelquefois routinières, d’autres fois nouvelles et innovantes. C’est un travail collectif de recherche sur le chercheur par les chercheurs eux-mêmes. Il marque aussi à sa manière un changement de culture qui vise à faire sortir le chercheur de son isolement, car le chercheur est encore souvent trop isolé sur l’Aventin de ses centres d’intérêt. Isolement aujourd’hui, largement interrogé dans tous les domaines scientifiques où le travail en équipe – dans le cadre d’une pluridisciplinarité – apparaît comme un possible renouveau. Renouveau des démarches et des protocoles dans un premier temps et peut–être des résultats dans un second. Évolution qui ne manquera pas de toucher et de modifier, voire d’enrichir, le travail du chercheur.
�
Quant à l’ouvrage et aux articles qui y sont présentés, ils confirment et/ou élargissent les propos tenus dès 1992 par Aumont- et Mesnier. Ses différentes approches (quantitative, qualitative, psychosociale, ergologique, sociologique, auto-analyse des pratiques de recherche…) et les propos tenus permettent au lecteur-chercheur d’engager un travail d’auto–réflexion sur sa propre activité ; il en fut de même pour moi. Comme pour l’équipe de chercheurs du LISEC, l’équipe ATIP, il fut une opportunité « de retourner un questionnement » vers le chercheur lui-même. Un pari à haut risque : celui de mettre à jour des écarts entre représentation de soi et activités réelles. Il est aussi un essai collectif pour comprendre comment le chercheur se « débrouille » (sic), comment il bricole et en quoi « son activité est vraiment singulière ». Il est évident pour moi, au regard des travaux d’Aumont et Mesnier, de Crawford et d’autres, dont les rédacteurs de la préface, que tout compte fait, hormis les matériaux utilisés et les procédures propres à la recherche, le chercheur n’est pas très loin de l’artisan qui maîtrise l’entièreté de la réalisation de l’œuvre. Il échappe encore aujourd’hui dans la plupart des cas au travail en miettes, au sens de Georges Friedmann, et à la taylorisation. Il est encore souvent épargné par une activité aliénante et déqualifiante que beaucoup connaissent même si parfois l’activité du chercheur peut lui apparaître « morcelée » et clairement en voie de diversification. Cependant, il n’est pas à l’abri de difficultés, de contradictions, d’injonctions contradictoires, d’évolutions personnelles ou institutionnelles qui l’amènent à se questionner sur lui, ses pratiques, son engagement et ses valeurs, ce que les auteurs de l’ouvrage pointent et soulignent. J’ai effectivement au cours des ans vu les conditions de réalisation de l’activité de recherche, écornée par un travail administratif plus prégnant et une « recherche » de financement toujours plus nécessaire auquel le jeune chercheur n’est pas toujours préparé. Ce constat fait par V. Boléguin et S. Guillon est sans doute une des évolutions essentielles de l’activité des chercheurs qui réduit du même coup (coût) les temps consacrés à la recherche disciplinaire. En d’autres termes, un paradoxe : une recherche qui nuit à la recherche et qui pour certains, dont moi, fut la cause d’une forme de retrait plus ou moins contraint ou légitimé par des dispositions et des valeurs personnelles.
Rentre aussi en ligne de compte pour le chercheur le sentiment d’efficacité personnelle évoqué par V. Boléguin et de sentiment d’auto-légitimité de ses productions scientifiques au regard de ses pairs. Question qui fut pour moi bien réelle au regard du peu d’intérêt suscité dans le monde universitaire par l’un de mes thèmes de recherche à savoir l’illettrisme des adultes qui rendit difficile la mise en débat de mes activités et la confrontation de mes résultats. Naquit un sentiment d’isolement du chercheur dans la conduite du travail partagé par d’autres, mais n’interrogeant pas néanmoins, pour autant, l’utilité sociale de mes recherches ni des leurs.
�
La contribution de Millet-Sonntag-Oget met à jour l’existence d’invariants dans l’activité du chercheur (enseignement-recherche-administration). Certes, cet ensemble de tâches a toujours existé, mais des évolutions dans ce cadre sont en cours et un déséquilibre semble s’accentuer du fait de l’augmentation du travail administratif. S’agit-il bien là d’une activité nécessairement dévolue aux chercheurs ? Sans pour autant en nier la nécessité pour le bon fonctionnement des labos, ne pourrait-elle pas être allégée. Evolution ? Évolution qui à terme pourrait avoir des conséquences sur la nature de la recherche, la qualité de ses résultats, etc. À la lecture, on le constate, l’activité du chercheur est multiple, mais les évolutions récentes évoquées ci-dessus (subventionnement, administration) tendent à rendent son cœur de métier de plus en plus difficile à exercer. Et pourtant, dans le même temps, la pression scientifique s’accroît quant au nombre de publications attendues dans les « meilleures » revues, malheureusement quelquefois les moins lues ou par les seuls initiés… ce qui pose problème quant à la diffusion des résultats de la recherche et l’accès du plus grand nombre, hormis les étudiants, aux savoirs produits par les universitaires et à leur réappropriation sociétale. Réappropriation sociétale, de mon point de vue essentielle, qui légitime le statut de chercheur, dans une logique de don et de contre–don, comme S. Kennel le rappelle. De plus, le métier et les activités du chercheur, comme d’autres sphères du travail, sont gagnés par les notions de « productivité » et de « compétition », comme autant d’exigences au détriment d’autres activités et peut-être contradictoirement avec le temps long souvent nécessaire à la recherche.
Par ailleurs, comme le remarquent Millet-Sonntag-Oget, il existe comme pour beaucoup de travailleurs un écart sensible entre le travail prescrit et le réel de l’activité… Travail prescrit sans beaucoup de précision par ailleurs lorsqu’on se reporte au Décret du 6 juin 1984 et à son Article 7. Le chercheur est soumis aujourd’hui, semble-t-il, là encore, aux mêmes aléas et pressions que tout producteur… Le chercheur est donc bien un travailleur comme un autre, soumis, lui aussi, à des évolutions sociétales sur lesquelles il n’a que peu de capacité de résistance. Une chute douloureuse d’un piédestal depuis longtemps érodé. La marque d’un privilège réel ou imaginaire d’une profession qui au fil des ans et des modes d’organisation du travail perd de sa superbe et se doit de revoir à la baisse les représentations symboliques d’elle-même et son construit social.
C’est bien le constat de L. Durrive. Pour lui, « l’activité du chercheur n’a rien de désincarnée ». Le chercheur n’est pas un pur esprit et affirmer que son travail est une pure activité cognitive ne serait pas sérieux ou réel, ce qui était déjà affirmé par Aumont-Mesnier et -Crawford. Mais le risque est qu’elle devienne une « activité productive banale » face au double mouvement exercé par la pression managériale et le productiviste venu de l’extérieur ? Le chercheur est donc « un travailleur comme un autre », certes un peu « particulier », mais de fait comme tout travailleur a sa particularité. Ce qui remet quelques pendules à « leurre » du réel social en redéfinissant la place aujourd’hui donnée, imposée (qui ne fut pas toujours la même) aux chercheurs dans une société en mouvement. Évolution qui au fil des générations modifie les statuts et les représentations de soi et des métiers. Mais, peut-être, est-il utile de rappeler à une corporation parfois élitiste que « le chercheur travaille, [et] il est un humain semblable à tous les autres ».
Au demeurant, ce qui confirme la « normalité » du chercheur, est que le métier s’apprend au fur et à mesure de l’exercice de l’activité et de ses premiers résultats, comme le note M. Faury. En effet, le doctorant, l’apprenti en recherche, comme tout apprenant en fin de cycle, n’est pas au bout de ses apprentissages. De facto, « les doctorants n’ont pas en général une vision exhaustive des activités des chercheurs après la thèse ». Comme pour tous les métiers, la fin d’études et l’entrée dans le monde du travail ne sont pas la fin des apprentissages. Comme tous les métiers, le métier de chercheur s’acquiert aussi dans le temps, par l’expérience et la confrontation avec les pairs… de la même manière que les infirmières dans les salles de repos où les échanges et le babillage sont un complément indispensable aux acquis en IFSI. Au risque d’une banalité, il est possible d’affirmer qu’on ne naît pas chercheur, mais qu’on le devient.
�
E. Triby confirme que le chercheur n’est pas un pur esprit et que son activité corporelle est bien présente lors de son travail cognitif. Ainsi pour lui, le métier de chercheur est aussi un art du corps et le chercheur est à sa manière l’acteur-auteur d’un spectacle vivant. Reste à savoir si le corps de la recherche et le corps enseignant, sont le même corps ou des corps différents. S’il y a des fonctionnements et des postures spécifiques à tel ou tel moment de l’activité et du rôle qui y est assumé… La question mérite encore débat et, sur ce point, la recherche devra être prolongée. Reste que trop souvent à l’université, j’ai pu le constater, l’oubli du corps pourtant outil du chercheur, est assez fréquent. Or, à sa manière, le chercheur fait « corps » (et âme) avec sa recherche. C’est une autre marque de la survalorisation de la dimension cognitive du travail de recherche. Mais peut-on penser, chercher et trouver sans recours au corps ? Comme les autres travailleurs encore une fois, il n’y a pas de travail, d’activité sans corps, comme il n’y a pas d’activité et main sans cerveau, comme l’affirmait il y a bien longtemps Sébastien Faure en matière d’apprentissage. Nous pourrions pour le dire autrement, en se référant aux sagesses ancestrales énoncées par Juvénal « mens sana in corpore sano ». Un corps de la recherche ou plutôt du chercheur, un corps multiple qui fait corps avec la paillasse, corps avec les manips, corps de la lecture, corps des échanges entre pairs, corps de la communication savante, corps de l’analyse, corps de l’écriture…… autant de corps ou de posture « en–corps » à interroger. Il s’agit bien de refuser la dichotomie, peut–être emprunte de religiosité, entre connaissance et action. Il faut de l’action pour connaître et faire connaître, et de la connaissance pour agir.
Toujours dans la même veine d’un chercheur travailleur parmi les travailleurs, celui-ci est amené à coopérer et à engager pour créer des activités transactionnelles centrées sur la relation entre les acteurs comme le font de nombreux autres professionnels dans le travail social, le management, la production industrielle ou de services… ce que souligne N. Lavielle-Gutnik en particulier dans le cadre trop souvent décrié de la recherche-action qui implique l’immersion dans un collectif de « cherchants » professionnels ou pas. Les chercheurs sont conduits par ailleurs à faire œuvre « au sein de la communauté » de recherche et à user largement de la communication, autres pratiques sociales pointées par M. Faury et S. Kennel.
Si le chercheur n’est pas que pur esprit et s’il fait corps avec ses activités variées, il est aussi nécessairement « émotion », ce qui l’associe pleinement dans toutes ses dimensions au genrehomo sapiens. Il est donc, au terme de cet ouvrage, non seulement un travailleur de plein exercice, mais aussi un être humain de pleine activité dans un environnement pluri-institutionnel, voire pluridimensionnel. Double dimension qui là encore, comme dans beaucoup d’activités liées au réel du travail selon M. Roux, implique pour le chercheur et le travailleur de développer « des compétences d’adaptation » qui participent en dynamique à la construction du sujet.
Si quelquefois le travail du chercheur contribue à changer le monde, il faut en convenir, la recherche et ses multiples implications personnelles effectuent un travail de transformation du chercheur lui-même qui touche sa sensibilité, ses pratiques cognitives, son corps, son mode d’implication sociale et parfois ses valeurs. En d’autres termes, la recherche sur la durée n’est pas sans effet sur le chercheur lui-même. Le travail de recherche comme toute activité participe de la construction identitaire personnelle et professionnelle de l’individu.
�
Quelques pistes pourraient encore être ouvertes, me semble-t-il, sur le travail du chercheur. D’une part, celle de l’évolution de ses activités au regard des avancées en matière de traitement numérique, voire des effets de l’intelligence artificielle sur le recueil et le traitement des données (protocole, échantillon et résultats…). D’autre part, il conviendrait d’évoquer à tout hasard la souffrance au travail du chercheur… une piste, à ma connaissance, à ce jour inexplorée. Il s’agirait de s’interroger, à la suite d’Yves Clot, afin de savoir si un chercheur accepte ou est contraint d’agir contre lui et contre l’autre, en conscience ou non. En bref, s’il se retrouve dans une forme de « souffrance éthique (…) […] lorsque ce qu’on lui demande de faire, vient en opposition avec ses normes professionnelles, sociales, subjectives », lorsqu’il est mis face « à des impératifs dissonants » (Clot, 2010, p. 118) soit cognitivement, soit en rupture avec l’éthique de la recherche.
�
Pour conclure
Ainsi, l’ouvrage collectif au long court sur les activités du chercheur conforte la position que j’évoquai au début de mon propos. Il tend à prouver (même si les travaux d’analyse sont encore à pousser) que l’hypothèse de Pierre Besnard à laquelle j’adhérai était fondée. En effet, les activités du chercheur pointées dans l’ouvrage, comme ses méthodes de travail, ses postures professionnelles, ses émotions, ses mobilisations cognitives et corporelles, sa culture et son éthique… tendent à prouver que le chercheur est un travailleur comme un autre qui mobilise selon les moments de son labeur toutes ses capacités professionnelles, individuelles et relationnelles…… Ces premiers résultats prometteurs demandent certes à être approfondis par une enquête plus solide et pluridisciplinaire sur un échantillon significatif de chercheurs. Ils ne demeurent pas moins éclairants sur la nature des travailleurs de la recherche. Certes, ces résultats partiels écornent parfois l’image que certains se font de leur statut, mais n’est-il pas essentiel de, quelquefois, rappeler une corporation au réel de son activité… et de mettre fin à des illusions de fait déjà perdues.
�
Mais Or, cette perte d’illusion ne retire rien à la noblesse de son activité. Le chercheur ne serait-il pas, tout compte fait, une sorte de compagnon du savoir souhaitant comme d’autres réaliser son chef–d’œuvre ? D’abord aspirant, puis compagnon et enfin « maître ». En d’autres termes, il est le résultat d’une longue itération, à la manière d’un tour de France, où se construit, pas à pas, la maîtrise de la méthodologie, la rigueur des protocoles scientifiques (une autre forme de tour de main), l’élaboration des concepts… et la rigueur épistémologique. Autrement dit un parcours vers l’expertise de l’activité, l’expertise métier. Une aspiration commune à tous, celui du compagnon, de l’ouvrier, de l’employé. Une aspiration partagée, celle de la recherche d’un travail qui prend sens, celle du travail bien fait et de l’utilité sociale de l’action.
Activités où sont mobilisés dans un même élan la main et l’esprit, revendication incessante de la pédagogie libertaire qui visait à mettre fin à une dichotomie illégitime, à mes yeux, celle qui prônait la noblesse du travail de l’esprit et la petitesse de celui de la main. Heureusement aujourd’hui et pour le coup, grâce au travail des chercheurs, nous savons que tout acte mobilise des ressources cognitives et que, du coup, tout « faire » recourt et mobilise à de l’intelligence.
AÀ ce point de ma réflexion et de mon propre itinéraire de recherche, j’avancerai que le chercheur, travailleur intellectuel (mais pas que) n’est pas très différent, dans l’activité et la tentative répétée de la maîtrise de la tâche, du forgeron, de l’ajusteur, de l’infirmière ou du tailleur de pierre. En bref du compagnon et que possiblement, il pourrait s’inscrire dans un même système de valeurs dont se revendiquent les Compagnons charpentiers du Tour de France à savoir : « Servir, Ne pas se servir, Ne pas [s’]asservir ».
�
Références bibliographiques
Aumont, B. et Mesnier, P.-M. (1992). L’acte d’apprendre, Paris, PUF.
Besnard, P. (1978). Les syndicats ouvriers et la Révolution sociale, Besançon, Ed., Le Monde nouveau.
Clot Y., (2010). Le travail à cœur, Paris, La Découverte.
Crawford, M. (2016). Éloge du carburateur, Paris, La Découverte.