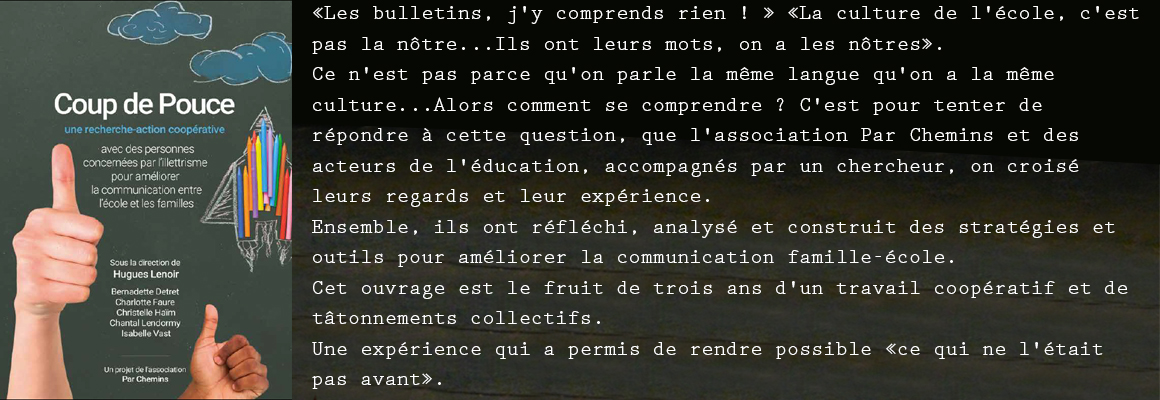Reims 2015
Culture et maîtrise de la langue
(re)trouver le goût d’apprendre
« Les gens qui veulent toujours enseigner,
empêchent beaucoup d’apprendre »
Montesquieu
Avertissement, cette synthèse n’a aucune prétention à l’exhaustivité ni à l’objectivité absolue malgré une distanciation nécessaire à sa rédaction. Elle est un reflet de deux jours de réflexion et de travail collectif sur le lien qu’entretiennent Culture et usage d’une langue. Elle est par ailleurs le fruit d’une écoute attentive d’un auditeur-rédacteur certes attentif mais en aucun cas infaillible. Au-delà, au fil du récit, je me suis autorisé à ajouter quelques touches personnelles en lien avec mes préoccupation d’acteur et de chercheur sur un terrain que j’ai de nombreuses fois arpenté.
Avant de reprendre les travaux du colloque de Reims qui s’est déroulé les 1er et 2 octobre 2015, revenons sur son sous titre en lien immédiat avec cette sentence en exergue du philosophe du 18e siècle. Ce goût ne serait donc pas définitivement acquis même s’y apprendre fait partie des premiers actes de la vie comme respirer, marcher, parler… Il y aurait donc des « empêcheurs » d’apprendre qui par intention, maladresse, inattention pourraient produire un effet néfaste sur les apprentissages jusqu’à en dégoûter certains. Une telle réalité est donc à méditer. Comment faire individuellement et collectivement pour entretenir, développer ce (son) goût d’apprendre ? Nous y reviendrons comme le firent quelques intervenants, mais soulignons-le, la question est centrale et renvoie chacun d’entre-nous à ses responsabilités, comme individu responsable de lui-même, comme éducateur devant, comme le proposait déjà Pestalozzi, permettre à chacun de « faire œuvre de soi-même ». Ou encore comme citoyen devant veiller qu’une société qui se veut de la connaissance permette à chacun et à tous, à la suite de Michel Foucault, de gérer «sa propre vie comme œuvre d’art personnelle »[1] en mobilisant les moyens offerts pour son auto ou son hétéro développement intellectuel ou manuel. En effet, la culture ne peut se limiter à la dimension intellectuelle du faire mais devrait aussi favoriser la production d’objet « d’art » de soi, éventuellement socialement reconnus. Ceux qui œuvrent à l’éducation et à la création de tous pourraient, à mon sens comme le proposait le grand pédagogue Sébastien Faure, avoir le souci de ne « pas créer de cerveau sans main et de main sans cerveau ». �
Au-delà de ces quelques considérations liminaires, ce colloque annuel de l’association Initialesne s’est pas limité à interroger ce goût d’apprendreou de re-apprendre. Il visait en premier lieu à échanger et à se cultiver sur les liens entre Culture et maîtrise de la langue en laissant entendre « entre les signes » que la culture favorise l’accès et l’usage de la langue et que dialectiquement l’accès et l’usage de la langue favorise l’accès à la Culture. C’est ce pari que relevèrent les participants intervenant de la tribune ou de la salle lors de nombreux et fructueux échanges. Les interventions et les témoignages d’acteurs furent souvent (toujours) complémentaires et soulignèrent que la culture avec ou sans majuscule est un vecteur essentiel de socialisation, de restauration narcissique et de réalisation de soi, seul, mais aussi (toujours) par et avec les autres. Et qu’elle est aussi un vecteur de coopération, de tolérance et de reconnaissances des altérités.
Le goût d’apprendre
Paradoxalement, mais n’est-ce pas l’essentiel, les premières interventions se concentrèrent sur les moteurs qui permettent et/ou déterminent les apprentissages, à savoir la motivation et la confiance. Pierre Frackowiak a rappelé que le goût, le plaisir et le désir d’apprendre étaient étrangers aux programmes scolaires et que ces notions, ces invariants appartiennent trop souvent aux discours sans qu’ils trouvent toujours toute leur place dans les institutions éducatives. Après avoir souligné que les fondamentaux relevant du socle de compétences n’avaient jamais été ni oubliés, ni négligés, il s’est par contre demandé si tout était toujours entrepris pour donner et entretenir ce goût des savoirs. En effet, avant même de s’interroger sur le « re-donner » encore faut-il se demander si ce goût a pu toujours naître voire même s’il n’a pas été « quelquefois étouffé à l’école »[2]. Ainsi pour lui, il conviendrait d’abord de « médier avant de remédier ». C’est-à-dire de permettre à ce goût d’apprendre de s’installer avant même d’évoquer de quelconque actions curatives. S’inscrivant dans les pas de nombreux pédagogues comme Carl Rogers, Bernard Charlot et les socio-constructivistes, Pierre Frackowiak a énoncé les principaux dangers qui guettent la motivation à apprendre : l’absence de sens et l’émiettement des savoirs (peu ou pas de transdisciplinarité) ; l’absence de lien entre les connaissances proposées et le réel de la vie (usage et transfert des connaissances), sans lien avec une histoire individuelle ou collective ; une didactique « mécanique » qui vise plus à l’application qu’à la construction des savoirs. Il s’agirait donc pour ce dernier point essentiellement de favoriser l’apprendre à apprendre déjà proposé par William Godwin ou encore Michel Montaigne, militant pour des têtes bien faites plutôt que des vases « bien » pleins. Il convient aussi, selon lui, d’oser parler de « l’ennui »trop souvent vécu par certains apprenants et souvent source de démotivation et de « présentéisme »[3] et qui, à terme, risquent d’être « décrochés ». Ce constat implique donc de s’intéresser à chaque apprenant afin que tous puissent s’engager en éducation à partir de leur goût, « de ce qu’ils savent, de ce qui les mobilisent » et afin mettre l’apprenant au centre de ses apprentissages, posture plus souvent incantatoire que réelle. En bref, cette intervention fut un plaidoyer argumenté et soutenu, n’en déplaise aux tenants de l’anti-pédagogisme, quant au bénéfice des pédagogies actives et coopératives sur le développement et l’entretien du goût d’apprendre et sur l’acquisition des connaissances.
�
�
La nécessaire confiance
Pour Philippe Bonmarchand, dans les processus d’apprentissage, la confiance et le respect apparaissent comme des conditions sine qua nonà l’apprendre qu’il s’agisse de la langue ou d’autre chose. Ce point de vue fut largement développé dans la littérature pédagogique en particulier dans Liberté pour apprendre[4]. La confiance doit être octroyée selon le conférencier en fonction de trois critères, celui de l’incertitude, rien n’étant absolument sûr, il y a toujours une marge d’erreur donc, il convient de faire confiance a priori. Celui du risque volontaire, en d’autres termes, le pari inconditionnel sur l’autre. Celui de l’engagement maîtrisé, la confiance est donnée mais négociée et les résultats de l’action évalués. Confiance pour apprendre, soit, mais dans la réciprocité et la distributivité. En effet, l’éducateur doit donner sa confiance mais aussi être de confiance et il doit recevoir en retour la confiance de l’apprenant et du groupe en formation. Groupe, lui-même engagé dans une dynamique de confiance collective nécessaire aux échanges et à l’indispensable conflit socio-cognitif. La confiance est donc le fruit d’une co-production des acteurs qui aboutit à la mise en place d’un climat favorable aux apprentissages individuels et collectifs. Elle se construit donc plus qu’elle ne se donne. Quant au respect de l’autre, il précède quelquefois de la confiance offerte, d’autres fois en résulte, mais il est tout aussi indispensable à l’établissement d’un climat propice, productif et créatif. Il convient donc de veiller à cette double exigence – confiance et respect – comme étant des éléments constitutifs et incontournables de toute relation pédagogique équilibrée et par conséquent de tout apprentissage.
La vulnérabilité
Faute de confiance en eux, dans leur culture d’origine et dans l’environnement éducatif, certains lycéens d’origines diverses, plutôt populaire, des lycées professionnels en particulier, peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité. En effet, comme le souligna Adeline Sarot, cette non considération de soi, de sa culture et de sa langue d’origine entraînent chez certains des troubles identitaires. Suite à une « rencontre traumatique »[5] avec l’école se produit une disjonction entre culture d’origine et culture scolaire du pays de résidence, entre culture d’ailleurs et la culture légitime d’ici d’où l’importance d’engager un processus – de fait un travail au sens psychologique du terme – de légitimation et de reconnaissance réciproques des cultures, incontournables et utiles aux apprentissages. Travail visant à alléger « une charge émotionnelle »trop forte, inhibitrice face à une culture dominante, quelquefois étrange voire dérangeante dont il peut résulter une forme de complexe de classe ou plutôt un complexe de culture déstabilisateur. Il est donc plus qu’utile de mettre en œuvre des moyens favorables à une déconstruction-reconstruction des représentations pour briser ce mouvement de vulnérabilité des jeunes apprenants peu favorable, quelquefois même nuisible, aux apprentissages. Par contre, selon la conférencière, une fois dépassés, par un acte de parole, par une prise de conscience, cette « colère culturelle » et ce « handicap colonial » qui bloquent souvent le désir d’apprendre, il est possible de parvenir à une acceptation de soi et de ses héritages et de se (ré)engager dans des apprentissages quitte à les métisser. Ainsi « au silence des origines » se substitue une acceptation, voire une recherche de savoirs et d’une culture d’ailleurs à articuler à ceux d’une scolarité et d’une société d’accueil.
L’engagement
�
L’engagement en formation fut aussi l’objet d’une intervention des formateurs-chercheurs de l’association Lire et écrire. Ceux-ci sans renoncer à la dimension émancipatrice de l’alphabétisation[6] se sont interrogés sur les motifs et les motivations, ainsi que sur les parcours, des ceux et celles qui entrent en formation. Cette recherche, dont les résultats définitifs sont encore à consolider avant publication[7], est d’ores et déjà instructive. Elle fait apparaître que les dynamiques d’entrées en formation et les événements déclencheurs sont multiples et complexes, très différents d’un individu à l’autre. Pour les chercheurs, les difficultés à lire et à écrire ne sont pas toujours les (seuls) déterminants car bien d’autres choses se jouent en formation selon la situation des uns ou des autres. Parmi les premiers résultats, il apparaît encore que la dynamique motivationnelle est un processus temporel changeant qu’il convient d’entretenir. Entretien qui relève autant de l’individu lui-même que du dispositif et des formateurs qui y œuvrent et dans lequel la confiance évoquée plus haut apparaît comme une pièce maîtresse. Confiance en les autres mais, aussi et surtout, en soi et en ses capacités, autrement dit dans la croyance en son sentiment d’efficacité personnel tel que défini par Albert Bandura. De plus, cette recherche-action affirme l’importance d’une confiance, non plus dans les acteurs, mais dans le lieu de formation, défini comme un « espace transitionnel » en résonnance avec les travaux du psychanalyste Donald Woods Winnicott. Espace protégé où l’erreur n’est pas faute et où l’apprenant peut se mettre à l’épreuve, se jauger, (s’)expérimenter en toute sécurité, restaurer l’image de soi avant de se lancer et de s’exposer à l’extérieur. En d’autres termes, l’espace et le temps de formation dans tel lieu permettent d’engager la séparation d’avec une image ancienne et d’accepter sa confrontation au monde. Par ailleurs, les résultats confirment, une fois encore, combien il est essentiel que le savoir fasse sens (chercher, penser, débattre, agir) afin d’être approprié et transféré dans d’autres situations sociales ou professionnelles par les apprenants.
�
�
�
�
�
La valorisation
La valorisation des réalisations et des objets culturels réalisés par les apprenants est apparue lors du colloque comme une autre forme de reconnaissance de soi et de ses appartenances collectives autant qu’une résultante de l’engagement. Non seulement dans le cadre de productions culturelles, théâtrales, audio-visuelles ou en atelier d’écriture, etc., on y apprend mais encore en se donnant à voir ou en exposant des créations individuelles ou collectives on prend place, toute sa place, dans la société. De plus, la valorisation, au-delà d’être un moteur pour poursuivre les dynamiques de l’apprendre, permet d’une autre manière de briser des représentations sociales. La présentation au public des réalisations de la troupe Alexis, du travail sur les mots qui cachent et produisent des images[8], d’écriture poétique ou d’ateliers d’art plastique suivis par des détenus ou de la réalisation d’une exposition favorisent l’émergence d’une image positive de soi et du collectif. Toutes ces manifestations permettent d’enclencher et d’entretenir la motivation, l’apprenance de ceux et celles qui souhaitent s’approprier des connaissances utiles à leur devenir et facilitent l’insertion ou la réinsertion du sujet et des groupes qui s’y impliquent. La présentation de la fête de la lecture de Revin et des réalisations d’apprenants en furent une autre belle illustration.
�
L’écriture
Le travail d’écriture poétique ou non est souvent l’occasion d’un engagement individuel et de groupe et il donne parfois (souvent) l’occasion d’une valorisation extérieure. Les nombreux livres de productions des ateliers d’écriture, le festival de l’écrit et Dis moi dix mots en sont des illustrations probantes en Champagne-Ardenne. Reste que la poétique est aussi politique au sens où elle est un moyen culturel de (re)prendre pied par l’écrit dans la vie sociale et de restaurer ou de renforcer son image de soi. Elle est à la fois expression de soi et fondatrice de liens avec l’autre et les autres. Anne Vulpas a en effet insisté sur « la puissance de vivre »[9] que donne l’usage du mot et la création. La maîtrise de la langue qui consiste à la faire sienne est en ce sens une « conquête de la liberté » et une voie, une voix, facilitant les transformations individuelles inhérentes à tout engagement en formation comme l’avait rappelé l’équipe de Lire et écrire. L’écriture poussée à son paroxysme poétique peut être l’occasion de changer de langue, d’accéder à d’autres modalités et d’autres niveaux d’expression, voire d’en accepter une autre, ou même de changer de corps. L’atelier d’écriture, l’atelier poétique devient et se révèle à son tout comme un espace transitionnel, « une bulle de liberté » où il est possible de se projeter, d’inventer, de s’inventer. A condition toutefois, comme le souligna l’intervenante, que la relation pédagogique avec le poète-formateur demeure horizontale, la moins asymétrique possible. Relation égalitaire autorisant à la création et à l’apprendre.
�
Varia
Ces deux journées furent encore ponctuées par des intermèdes culturels dont une intéressante approche-découverte de l’alphabet par le théâtre et de nombreux retour d’expériences. Que cette expérience ait lieu en maison d’arrêt afin de préparer non seulement le retour à la vie (la réinsertion) en mobilisant « une pédagogie du détour »[10], en favorisant une pédagogie inductive, du travail sur projet culturel – une artothèque– mais aussi des processus de (re)construction de son image de soi. Projet dans des lieux d’enfermement qui visent à « offrir tout à tout le monde »y compris les détenus un peu à la manière d’Antoine Vitez qui se proposait dans le cadre de l’éducation populaire d’œuvrer à « l’élitisme pour tous » et de sortir de « l’empêchement de penser ». Que celles-ci, sous forme de témoignages fassent découvrir et comprendre combien il est difficile d’accéder aux savoirs de base et à une réelle autonomie sociale du fait d’un lourd handicap ou que l’accès à la maîtrise de la langue soit pour les réfugiés une possibilité, comme le déclara Mehmeti de « commencer une meilleure vie et de participer à la vie sociale ». Enfin, pour faire lien avec le colloque de 2013, l’équipe de Canopé a présenté à l’assemblée de nouveaux outils d’apprentissage mobilisant les technologies de l’information souvent pensées pour la formation initiale mais utilisable en éducation des adultes et facilitant l’accès à la culture numérique aujourd’hui nécessaire à l’autonomie de tous et au développement de la confiance en soi des apprenants. En bref des supports, quelquefois ludiques « pour bien cogiter ».
Pour conclure
En amont et en aval du colloque de Reims en 2015, certains intervenants institutionnels ont soulevés quelques interrogations essentielles quant à la maîtrise de la langue et à l’accès à la -ou à une autre – culture. La toute première interrogation posait la question de cette maîtrise et de sa relativité, tout d’abord en interrogeant le pourquoi faire de cette maîtrise. Vise-t-elle l’insertion, le lien social, la citoyenneté, le travail, l’émancipation ? Ensuite que signifie le mot « maîtrise », terme qui renvoit tant pour la langue que pour la culture, à une forme d’expertise qui est sans doute le travail d’une vie. La deuxième question portait sur la cartographie de cette maîtrise. Un intervenant rappelait à juste titre la préoccupation d’un élu breton quant à la formation. Pour celui-ci, il fallait certes la penser, à la suite de Condorcet, non seulement « tout au long » mais aussi « tout au large de la vie » afin de briser l’usage utilitariste et limité de l’accès à la langue et de veiller à dépasser cet usage restreint pour accéder, aussi et nécessairement, à la culture. Enfin Claire Extramiana a souligné combien le défaut de maîtrise de la langue produisait une réelle insécurité linguistique souvent productrice d’insécurité sociale telle que décrite par le sociologue Robert Castel.
En 2013, le colloque de Reims avait soulevé le risque de rupture numérique mais il en existe au moins une autre sur laquelle, me semble-t-il, il faut attirer l’attention et être vigilant. En effet, certains auteurs font remarquer une forte cassure culturelle, une quasi rupture de classe en les tenants de la culture savante et légitime des héritiers décrits par Bourdieu et les couches les plus populaires. Deux citations pour illustrer ce propos d’abord celui Dominique Pasquier qui rapportait les résultats d’une enquête de Véronique Le Goaziou à propos des adolescents de milieu populaire et de leur rapport au livre et à la lecture dans le cadre de l’émission de France Culture animé par le philosophe très conservateur Alain Finkielkraut le 11 juin 2005. Pour ces jeune, rappelait le rapport : « il ressort très nettement que la lecture est associée dans leur esprit à des gens âgés, à des bourgeois, à des gens qui n’ont rien d’autres à faire. Le mépris est très fort, le livre est étranger, et ils n’en éprouvent aucun sentiment de culpabilité »[11].
Ainsi, selon l’étude évoquée, la lecture ne représente plus ni un outil d’intelligence et de compréhension du monde ni une occasion d’émancipation mais un instrument à usage des classes dominantes, des « rentiers » et à des anciens à la culture dépassée. Ce qui a pour conséquences un recours massif à d’autres supports : jeux vidéo, téléphones « intelligents » et aux réseaux sociaux qui deviennent les sources quasi exclusives visant à assouvir leur curiosité et pour quelques-uns leur appétit de savoir. Reste à s’interroger sur l’accès à un esprit critique qui seul permet de démêler sur la toile le vrai du faux, le scientifique de l’à peu près du café du commerce. Autre « témoignage » dans le roman Eddy Bellegueule : « parler philosophie, c’est parler comme la classe ennemie, ceux qui ont les moyens, les riches. Parler comme ceux-là qui ont la chance de faire des études secondaires et supérieures et, donc, d’étudier la philosophie »[12]. Constat désarmant mais qui de fait n’est pas nouveau, comme le soulignait Pierre Frackowiak en début de ce colloque le « c’était mieux avant » et le retour au paradis perdu de l’éducation des hussards noirs est un mythe voire un leurre. Freinet en son temps déjà constatait certaine forme de résistance à l’école et de désengagement : « les enfants d’aujourd’hui, écrivait-il en 1964, ne s’intéressent plus à l’école, ils croient tout connaître et ne savent même pas lire correctement. Ne parlons pas de l’orthographe qui est désastreuse et des acquisitions scolaires toujours insuffisantes. Le travail scolaire ne les intéresse pas parce qu’il ne s’inscrit pas dans leur monde. La litanie est longue, mais les faits sont là… Il faut trouver autre chose »[13]. La question du sens des apprentissages et de ses modalités pour apprendre était déjà posée, une vielle question toujours d’actualité en filigrane encore en 2015. Mais de fait l’optimisme ne doit pas quitter le « pédagogue », l’éducateur, comme l’ont montré les interventions du colloque. La remédiation est toujours possible pour peu que le savoir prenne sens pour soi et son devenir. Georges Lapassade dans un texte intitulé Ethnographie de l’école évoquait le fait suivant chez les fermiers de l’île Mindoro aux Philippines : « les Hanumoo reçoivent une formation informelle pour apprendre à lire et à écrire, et, en fait, jusqu’à leur puberté ne sont pas intéressés par l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Chez les Hanumoo, la langue écrite et la lecture ne sont utilisées que pour courtiser, et au moment de la puberté les adolescents travaillent assidûment afin d’apprendre à écrire, jusqu’à ce qu’ils puissent graver des chansons sur des cylindres de bambou pour entretenir une vie amoureuse active. Ils achèvent alors leur alphabétisation en quelques mois »[14]. Le même constat, les mêmes courts-circuits furent faits par A.S. Neill avec les Libres enfants de Summerhillet l’on connaît aussi quelquefois dans son entourage, des individus qui ont appris à lire grâce aux Pokémons ou un indispensable « manuel » technique de console de jeux. Reste à donner à chacun le temps et l’opportunité de faire de soi une œuvre d’art. Pour cela, les éducateurs doivent peut-être méditer ces propos d’une militante aborigène en Australie, Lisa Watson : « si tu es venu pour m’aider, tu perds ton temps, par contre si tu es venu car ta libération est liée à la mienne, alors travaillons ». Autrement dit le savoir et la culture se conçoivent et se construisent dans la coopération et que dans tous les cas, quelque soit sa place et son statut il y a beaucoup à apprendre de l’autre et avec l’autre.
Hugues Lenoir
Enseignant-chercheur, Université Paris-Ouest,
membre du Lisec (EA 2310)
[1] Michel Foucault, entretien réalisé en 1984, cité par Corcuff Philippe, 2015, Enjeux libertaires pour le XXIe siècle,Paris, Editions du Monde libertaire, p. 164.
�
[2] Les termes en italiques sont de l’intervenant
[3] Il consiste à être physiquement présent mais sans une réelle implication dans les apprentissages.
[4] Rogers C., Liberté pour apprendre, (2013), Paris, Dunod, (1ere édition 1969).
[5] Les termes en italiques sont de l’intervenante.
[6] Lire et écrire est une association belge. Dans ce pays le terme alphabétisation est générique et englobe donc aussi la lutte contre l’illettrisme.
[7] A paraître courant 2016.
[8] Il s’agit du court-métrage Des mots et des images réalisé par Jean Bigot.
[9] Les termes en italiques sont de l’intervenante.
[10] Les termes en italiques sont des intervenants.
[11] Finkielkraut A., 2007, dir., La querelle de l’école, Paris, Stock, pp. 18-19.
[12] Louis Edouard, 2014, En finir avec Eddy Bellegueule, Paris, Seuil. Italiques dans le texte.
[13] Freinet C., Les techniques Freinet de l’école moderne, p. 7, Paris, Armand Colin, 1964, rééd. 1982, cité par Ducrot T., 2012, L’autogestion pédagogique, Lyon, chronique sociale, p. 67.
[14] Ibid., p. 146 in Georges Lapassade in Ethnographie de l’école,p. 76, document libre, non relié, non daté.