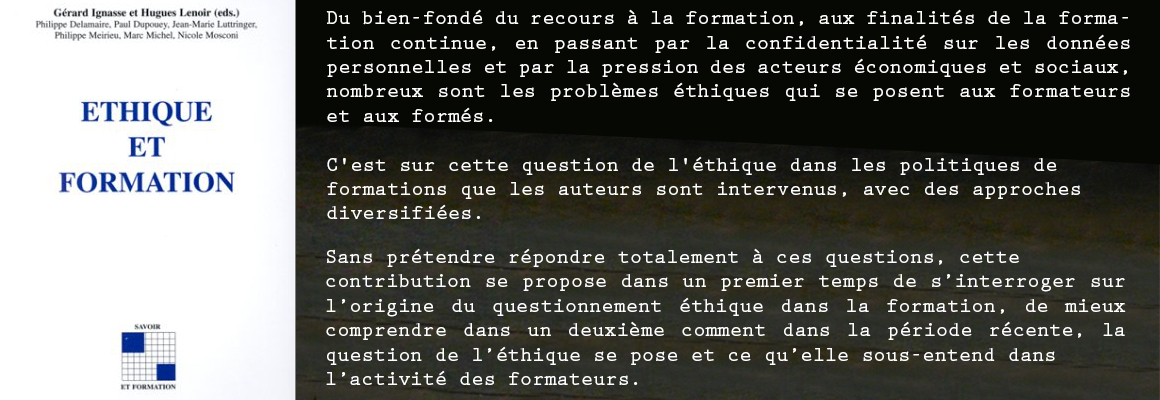CONTRADICTIONS SOCIALES ET FORMATION
entre rupture et suture
Ce texte se veut une contribution à un débat, à notre sens, toujours d’actualité, même s’il semble aujourd’hui quelque peu en sommeil. Peut-être sera-t-il l’occasion de relancer chez les formateurs, les gestionnaires et les organisateurs une réflexion sur les finsde l’éducation des adultes ? Il a pour objectif de rappeler, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité, quelques enjeux de la formation des adultes et de souligner que derrière la façade humaniste de “l’éducation tout au long de la vie” demeure un système institutionnel clivé où les contradictions sociales, selon les époques, se lisent plus ou moins facilement et qu’elles demeurent toujours – même lorsqu’elles sont en filigrane dans les périodes consensuelles – irrésolues.
Dès le XIXe siècle, le mouvement d’industrialisation sans précédent qui se développe fait apparaître des tensions radicales de plus en plus fortes entre deux pôles de la société française : une bourgeoisie industrielle et d’affaires installée et une classe ouvrière en constitution. Les révoltes lyonnaises des années 1830, les journées de juin 1848 à Paris, les cent jours de la Commune et la semaine sanglante de 1871 sont des illustrations extrêmes de la fracture sociale qui, alors, ne cesse de s’élargir. Dans la même période s’organise la discussion sur l’instruction du peuple[1]. Tous les discours y sont tenus, toutes les nuances de la pensée politique et sociale s’y entrecroisent et quelquefois s’y affrontent. Au coeur même du débat sur l’éducation se reflètent les jeux sociaux et leurs contradictions. La formation devient alors un puissant enjeu dans les projets d’organisation sociale. Elle est, pour les uns un outil de moralisation et/ou de soumission, pour d’autres un ressort permettant d’organiser le consensus, pour d’autres encore un moyen irremplaçable d’émancipation[2].
Ainsi, dès la seconde moitié du XIXe siècle, l’éducation des adultes apparaît au coeur d’un système d’enjeux souvent contradictoires qui, dans une première période, se renforcent et s’exacerbent, pour lentement au cours du XXe siècle s’atténuer, mais sans jamais totalement disparaître. Elle devient par là-même, selon les idéologies qui la servent, et qui s’en servent, un espace social qui se structure peu à peu dans un double mouvement qui est à la fois rupture et suture.
La formation entre rupture et suture
Rupture au sens étymologique du terme (du latin rumpere, rompre, briser), c’est-à-dire : “fait de se rompre, de se séparer brusquement en deux ou plusieurs parties, sous l’effet d’une force ou d’une poussée trop intense, d’un effort excessif ou trop prolongé ou d’un choc”[3]. L’histoire de la formation est pleine de “sismicité” à l’oeuvre, de mouvements tectoniques au travail qui pourraient, sous la poussée des contradictions sociales, entraîner l’éclatement des consensus autour de l’éducation des adultes : le mouvement des chômeurs de décembre 1997 l’illustra encore. Mais rupture aussi au sens plus nuancé “d’opposition ou d’une disparité soudaine et marquée entre les éléments d’une suite qui, jusqu’alors, étaient en accord ou en harmonie”[4]. Il ne s’agit plus, là, d’un simple écart momentané de positions parmi les partenaires sociaux tel que le rapport de Virville en fut l’occasion, lors de sa publication en 1996. Cette logique de rupture que porte en elle la formation prend donc, selon les contextes, un caractère plus ou moins accentué. Mais, que cette rupture soit radicale ou provisoire, la formation semble, en bien des lieux et des temps, une institution clivée en recherche d’équilibre toujours précaire et sans cesse menacé.
Suture au sens de “couture faite pour raccorder des tissus séparés par accident ou intervention chirurgicale”[5]. Car si l’éducation des adultes est un terrain de rapprochement d’intérêts divergents, ce rapprochement n’est pas toujours naturel et il ne s’opère pas sans volonté et sans artifice. Du liant lui est nécessaire pour exister. L’éducation des adultes, surtout du fait des usages sociaux qui lui sont dévolus, apparaît bien, en effet, comme un point de suture qui participe à une tentative de réduction de la contradiction sociale. Mais, du fait de n’être qu’un lieu de conjonction, elle demeure un espace interstitiel et fragile où peuvent resurgir, avec plus de facilité qu’ailleurs, les questions de toujours. Néanmoins, force est de constater que beaucoup lui octroient volontiers un rôle dans lequel se structure et se cristallise, concrètement et symboliquement, le jeu subtil de la conciliation. Elle soude et organise autour d’elle, même s’il demeure précaire, le consensus. La formation prend alors la fonction d’un “espace transitionnel”[6] où des conceptions antagoniques du monde se rencontrent, s’associent, convergent, font oeuvre commune mais sans jamais renoncer pour toujours à la séparation. Le co-investissement formation, qui vise à réunir dans une même mesure l’effort de l’individu et celui de l’organisation, témoigne de cette fonction de rapprochement. Mais l’on constate que la reconnaissance de la qualification produite dans ce cadre juridique, même si elle est prévue, n’est pas acquise, ce qui ne manque pas de mettre en question la qualité et la durabilité de la suture.
Suture, enfin, au sens d’articulation fixe et “immobile caractérisée par deux surfaces articulaires réunies par du tissu fibreux”[7], lorsque la formation et ses composantes s’engagent dans des phases de rigidification : par exemple, le passage de mesures conjoncturelles à des dispositifs structurels en matière de formation des jeunes en difficultés d’insertion ou des demandeurs d’emploi de longue durée.
Problématique et hypothèse
Nous avons bâti notre argumentation à partir de matériaux et d’observations accumulés sur une période de dix années. Elle s’inscrit dans un mouvement de compréhension des enjeux, des évolutions et des lignes de force qui se font jour dans la formation des adultes. Elle propose une clé de lecture sur laquelle fonder une problématique permanente.
En effet, cette dialectique de la suture et de la rupture, et la dynamique qu’elle soustend, favorisent le repérage du rôle de certains acteurs de la formation permanente. Elles permettent de resituer la formation dans une tension continue, et quelquefois contradictoire, entre développement des organisations et épanouissement des individus. Elles positionnent enfin la formation dans une problématique sociale plus large, en la situant au carrefour des évolutions de l’appareil de production de biens et de services, de la gestion des ressources humaines et de son utilisation comme outil de maintien de la paix sociale. En d’autres termes, et afin de préciser la problématique dans laquelle nous nous inscrivons, nous nous interrogeons sur la finalité des politiques de formation, au travers de leurs fonctionnalités, et sur la contradiction fondamentale qui semble présider et accompagner la mise en place et le développement de l’éducation des adultes depuis son origine. A savoir, est-elle un outil de gestion destiné à gagner la bataille de l’industrialisation et à accompagner les modernisations successives dans le cadre d’un développement conjoint des hommes et des organisations, auquel cas la formation jouerait un rôle de suture dans le corps social ? Ou est-elle une machine à produire des individus dressés “pour la servitude, au mieux des intérêts et de la sécurité des classes supérieures”[8] dont il s’agit de s’emparer pour en faire un levier d’émancipation sociale, auquel cas la formation aurait une fonction de rupture radicale.
Il va de soi qu’entre les deux termes de la contradiction, de nombreuses autres positions existent mais à notre sens elles n’obèrent pas la question fondamentale de l’usage social de la formation qui, selon les acteurs qui s’en revendiquent et la mettent en oeuvre, apparaît et ré-apparaît à toutes les époques. Ainsi, poser la question de l’usage de l’éducation des adultes entre suture et rupture nous semble, en cette année de refonte de la loi de juillet 1971, une manière de la remettre en perspective et de participer à une meilleure compréhension d’un fait de société que d’aucuns considèrent comme majeur et essentiel au développement des sociétés en cette aube du XXIe siècle.
Nous formulonsl’hypothèse que l’éducation des adultes est à la fois un instrument de cohésion et de dissociation sociales et que cette double fonctionnalité se retrouve à tous les niveaux et dans toutes les pratiques de formation mais à des échelles différentes et au service d’enjeux plus ou moins fondamentaux. En bref, que ce qui vaut en matière de “rupture et de suture” pour la formation des adultes en général, et dans le cadre du travail en particulier où la contradiction est la plus forte et la plus apparente, se retrouve aussi à l’Université où les discours et les pratiques de services communs de formation continue interrogent, inquiètent, divisent et rassemblent quelquefois la communauté universitaire, se lit aussi dans la mise en place des dispositifs et dans le choix des stratégies pédagogiques… Tout comme de notre point de vue, elle apparaît en filigrane dans la réflexion sur la qualité, l’ingénierie de formation, les nouvelles technologies éducatives, voire sur l’éthique. Ensemble de discours et de pratiques sociales, souvent contradictoires, qui possède à la fois des vertus fédératrices et provoque un effet de dissociation, mais qui est aussi une occasion de questionner et de renouveler ce domaine d’activité. En bref, nous pensons, malgré les discours unificateurs de surface, que quel que soit le contexte, son niveau d’exercice et ses enjeux, voire ses évolutions, craintes ou souhaitées, l’éducation des adultes et la chaîne d’activités qui s’y observe, se trouvent à la frontière de contradictions fortes, et peut-être irréductibles. Ces contradictions irréductibles, ces menaces de déchirures apparaissant alors comme l’une des constantes de la formation.
L’hypothèse qui sous-tend donc cette contribution est que la formation des adultes tout au long de son histoire s’inscrit dans une dialectique entre rupture et suture. Rupture parce qu’elle représente un levier d’émancipation sociale pour les travailleurs autant qu’un outil de domination pouvant accroître la fracture sociale. Suture parce qu’elle permet, suivant les contextes, l’exercice d’une forme de co-gestion organisée dans la perspective d’un consensus social conciliant les intérêts du travail et du capital.
Avant d’alller plus avant, et afin de mieux nous faire comprendre, un petit détour par l’histoire de l’éducation des adultes, sans toutefois vouloir la refaire, nous paraît opportun. Cette approche historique, permettra d’illustrer la permanence d’une tension dissociatrice au sein de l’éducation des adultes et rappelera en quels termes, au cours du XIXe, puis du XXe siècle, ces discours et ces pratiques, faits de ruptures et de sutures, se sont peu à peu organisés.
Approche historique
Cette dissociation s’observe dès la première moitié du XIXe siècle, lorsque certains théoriciens sociaux affirment que l’industrialisation exige que le niveau de connaissances générales des producteurs s’élève. Ces nouveaux besoins en matière de formation ne seront pas sans conséquence sur les conditions de vie sociale et professionnelle des travailleurs. Le débat autour des fins de l’éducation des adultes est déjà posé : doit-elle servir prioritairement au développement des organisations ou à l’épanouissement, voire à l’émancipation, des individus. Pour illustrer cette fissure “originelle”, rappelons les points de vue de deux théoriciens dont les positions, tout au long du siècle, serviront de références. Saint-Simon proclame “que l’instruction est nécessaire à l’avènement de l’ère industrielle, il est favorable à l’instruction des milieux populaires. Pour cela, Saint-Simon souhaite que la masse des travailleurs bénéficie d’une formation professionnelle qui les rende capables de bien exécuter les travaux qui leur sont confiés. Mais cette formation ne se borne pas dans son esprit au seul apprentissage du métier. Dans ce but, et tout en affirmant son hostilité à l’enseignement traditionnel fondé sur les humanités classiques, il souhaite pour tous une culture générale de type scientifique faisant appel à des notions de géométrie, de physique, de chimie et d’hygiène”[9] qu’il considère comme essentielle à la poursuite et au développement du mouvement d’industrialisation qui s’annonce. De son côté, Pierre-Joseph Proudhon critique et condamne “une instruction élémentaire qui tend à enfermer le travailleur dans l’étroitesse de ses fonctions parcellaires… à donner à des inférieurs juste le degré de savoir que réclame une conscience obéissante. Cette condamnation de l’école officielle va conduire Proudhon à prôner une instruction s’appuyant sur le métier et s’étendant tout au long de la vie”[10]. D’une certaine manière Proudhon, déjà, s’inquiète d’une mission strictement adaptatrice de la formation que d’aucuns critiquent aujourd’hui et qui fait clairement partie des objectifs et de la définition de la formation tels qu’ils apparaissent au livre IX du Code du travail. Si, de leur côté, Guizot, Thiers et Duruy, comme le souligne Noël Terrot, n’oublient pas le rôle politique et social de l’éducation, si elle participe à “la nécessaire moralisation des masses”[11] et au maintien de l’ordre social, il est évident qu’elle est aussi pour eux un outil d’adaptation des travailleurs, souvent issus du milieu rural, à la culture et au mode de production et de soumission industrielles. En effet, “il faut fixer les masses à la machine plus encore peut-être que leur donner les moyens intellectuels de la servir”[12].
L’inflexion de 1848
Dans ce système de positions éclatées, selon les périodes et en fonction des tensions sociales et de la nature des idéologies qui animent les classes dirigeantes, les discours s’infléchissent. Les discours éminemment réactionnaires de certains sont atténués par ceux d’hommes se réclamant peu ou prou de Condorcet et de la première République. La révolution de 1848 est à cet égard révélatrice. L’éducation, certes, doit permettre la modernisation et le progrès mais elle doit aussi modérer, voire désamorcer, la conscience de classe naissante en revivifiant le mythe consensuel de l’égalité républicaine. “Carnot s’inscrit (…) dans cet héritage de fraternisation entre les diverses catégories sociales. Comme l’écrit Delescluze le 25 janvier 1849 dans son journal, il s’agit “d’éclairer les privilégiés dont l’esprit a été faussé, les pauvres dont l’éducation n’est pas faite, de réconcilier les uns avec les autres avec l’égalité et la fraternité républicaine.”[13]Mais après la répression sanglante de juin 1848, conduite par Cavaignac, le discours de la classe “dangereusement” cultivée reviendra et donnera l’occasion à Falloux en 1850 de faire voter la loi qui aujourd’hui encore porte son nom et dont le but avoué est de moraliser une classe ouvrière naissante, déjà remuante et largement déchristianisée.
De crise en rupture, de révolution en répression, l’éducation et la formation associent ou éloignent. Elles sont le reflet de conceptions du monde qui divergent profondément et qui attribuent à la majorité des hommes des places et des rôles différents, définitivement attribués. Elles retraduisent à leur manière les grands cadres idéologiques : soumission des humbles, association capital-travail, intérêts irréductiblement contradictoires entre dominants et dominés.
Au-delà du mythe républicain d’une école unificatrice et égalitaire qui apparaît comme une position médiane dans le discours sur l’éducation, des points tranchés perdurent tout au long du siècle. Victor Duruy, bien qu’attaché à la moralisation du peuple, y voit une nécessité économique. Il s’inscrit avec d’autres dans un courant qui finira par dominer car au service d’une logique industrielle irréversible où éducation rime avec industrialisation. Il écrit en ce sens dans une circulaire de 1865 “dans les centres populeux, le perfectionnement des arts et l’industrie ont amené, pour le plus grand nombre, le besoin impérieux d’un enseignement intermédiaire”. Du côté de la classe dominante, la réunification des partisans et des adversaires de l’éducation s’opère sous la pression d’intérêts communs dans le cadre d’une république “bien tempérée” et de Jules Ferry, qui selon Louis Legrand, “est avant tout un homme d’ordre et que son action pédagogique s’inscrit dans une perspective délibérément conservatrice. S’il a oeuvré pour le prolétariat, ce fut, avant tout, par souci de discipline collective, pour améliorer le fonctionnement de l’organisme social, en un mot conformément à l’inspiration positiviste, pour mettre fin à la révolution”[14]. De l’autre, les universités populaires largement influencées par les anarcho-syndicalistes, même si d’autres sensibilités y sont associées,“cherchent à affranchir moralement (le travailleur) en le débarrassant de tous les dogmes et préjugés qui obscurcissent encore son cerveau”[15] afin d’accomplir l’oeuvre émancipatrice du prolétariat.
De notre point de vue, Madeleine Figeat et Bernard Charlot résument fort bien cette contradiction permanente qui se joue tout au long du XIXe siècle entre capital et travail et dont la formation, entre crise et consensus, entre rupture et suture, apparaît comme un indicateur et un révélateur de sens. Une citation extraite de leur ouvrage éclaire cette contradiction et permet de souligner parfaitement la tension dans laquelle la thèse que nous nous proposons de défendre se situe. En effet, si la grande industrie émergente a encore besoin de main-d’oeuvre non qualifiée, “qui se résigne aux nouvelles formes de travail (…) idéologiquement intégrée à la société industrielle (…), elle a également besoin d’une minorité d’ouvriers qualifiés pour fabriquer, entretenir et réparer les machines, exercer les nouveaux métiers, encadrer et organiser le travail (…). Il faut donc former une élite ouvrière dans des écoles professionnelles et techniques. Mais la bourgeoisie, tout en se plaignant d’une façon de plus en plus pressante de manquer d’ouvriers habiles et complets, freine tout au long du siècle l’élévation du niveau professionnel et technique de la masse ouvrière, car elle craint à la fois que la formation ouvrière la prive de cette masse de travailleurs non qualifiés dont elle a avant tout besoin, qu’elle encourage les ouvriers à la révolte et qu’elle fasse naître des prétentions salariales et sociales exagérées dans l’élite ouvrière nouvelle”[16].
De l’autre côté du miroir, particulièrement au sein de la minorité la plus consciente et la plus engagée de la classe ouvrière, regroupée autour des Bourses du travail et de Fernand Pelloutier, la formation, afin de résoudre la question sociale, est aussi largement sollicitée pour qualifier les travailleurs. Les Bourses du travail s’y emploieront. Mais le but de la formation est – il prime peut-être d’ailleurs – l’émancipation. C’est pourquoi Pelloutier dans un texte en date du 1er mai 1895 déclare que “la mission révolutionnaire du prolétariat éclairé est de poursuivre plus méthodiquement, plus obstinément que jamais, l’oeuvre d’éducation morale, administrative et technique pour rendre viable une société d’hommes fiers et libres ”[17].
L’éducation apparaît donc bien au coeur de la contradiction. Même si elle participe de la défense des intérêts immédiats du prolétariat par la qualification, elle est et sera un outil de la rupture, car elle est, aux yeux des premiers syndicalistes, l’un des leviers indispensables au progrès social et à la gestion fédéraliste de la société future.
Approche contemporaine
Au XXe siècle, le discours s’atténue en apparence : le propos émancipateur et “classiste” du syndicalisme révolutionnaire s’estompe pour un temps, les discours moralisateurs tiédissent, la classe dangereuse s’assagit. Nous entrons dans une longue phase où la formation des adultes rime avec modernisation et progrès social. Dans ce contexte, elle prend peu à peu une coloration de plus en plus professionnelle et un aspect de plus en plus consensuel. L’Etat s’affirme comme un acteur essentiel et favorise la structuration de l’appareil de formation professionnelle tel que nous le connaissons aujourd’hui. Mais derrière cette apparente cicatrisation ne retrouve-t-on pas, dilués, les germes de la fracture ?
La loi Astier, votée en 1919, vise aussi, pour une part, la formation des adultes, mais dans une perspective uniquement professionnelle. Au sortir de la guerre de 1939-1945, le plan Langevin-Wallon relance l’idée “d’un perfectionnement continu du citoyen et du travailleur”[18], mais l’histoire de la République ne permit pas sa mise en oeuvre. Les projets de l’après Seconde Guerre mondiale, souvent sans lendemain – comme le projet Berthoin qui se propose “d’offrir les possibilités d’un plein développement humain”[19] -, soit sont directement liés au besoin de former une main-d’oeuvre qualifiée, c’est le cas des organismes sous tutelle du ministère du travail et tout particulièrement de l’ANIFRMO (Association Nationale Interprofessionnelle pour le Formation Rationnelle de la Main d’Oeuvre) à connotation taylorienne, créée en 1949, devenue l’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes), soit s’inscrivent dans une logique de la réparation, celle de la deuxième chance.
La loi de 1959, appelée loi Debré, peut être lue et comprise dans le cadre de l’idéologie de la réconciliation et/ou de la suture que nous avons évoquée. Elle s’inscrit en effet dans le projet du gaullisme social où la participation, c’est-à-dire l’association capital-travail, se substitue à la lutte des classes qui, elle, se veut rupture. Cette loi vise explicitement à l’équilibre social et économique de la nation. Pour ce faire, elle se propose d’organiser largement, par la formation, la promotion sociale des travailleurs. Dans cette loi, la promotion sociale et la formation qui en découle bien souvent apparaissent en reflet asymétrique et contradictoire du “instruire pour révolter”[20] de Fernand Pelloutier, voire comme une tentative ultime d’y mettre fin. En effet, Michel Debré déclare en présentant le futur texte législatif : “Il ne faut plus que la vocation de la France soit la vocation de révoltés. L’avenir de notre patrie, l’avenir de nos libertés exigent la participation profonde d’une nation quasiment unanime à son destin.”[21]
Comme le fait remarquer Noël Terrot, “à partir de 1963, la politique de formation des adultes se confond avec la formation professionnelle et n’intéresse plus que celle-ci”[22]. Elle devient dès lors “une obligation nationale”[23] dont l’objet essentiel est de “permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail”[24]. Même si nous partageons globalement le point de vue de l’auteur, dans le cadre de notre problématique articulée autour des idées de rupture et de suture, il nous paraît nécessaire de nuancer ce propos. Il est évident que les lois votées après cette date font une large place à la dimension professionnelle de la formation. Remarquons toutefois qu’aussi bien la loi du 31 décembre 1968 que celle issue de l’accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, adoptée le 16 juillet 1971, ménagent un espace au développement personnel. En effet, l’article L. 900-2 du Code du travail prévoit que les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances “ont pour objet d’offrir aux travailleurs, dans le cadre de l’éducation permanente, les moyens d’accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau de culture ainsi que d’assumer des responsabilités accrues dans la vie associative”[25].
Cette loi de 1971, directement issue du Protocole de Grenelle, est encore un exemple de cette utilisation de la formation comme suture. En effet, après la grande rupture de la même année entre la jeunesse et les travailleurs d’une part, et un mode de développement d’autre part, celui lié aux valeurs de la société de consommation, comment ne pas voir dans cette loi l’une des facettes de la réconciliation ? Son objectif avoué n’est-il pas des plus consensuels : permettre à la fois la modernisation des organisations et le développement des hommes ? Réconciliation inégalitaire soit, car l’organisation prévaudra dans bien des circonstances, mais réconciliation tout de même. Pour étayer notre démonstration, rappelons que tous les grands textes de loi depuis 1970, à une exception près la loi quinquennale du 20 décembre 1993, ont toujours été précédés de discussions et d’accords interprofessionnels entre les partenaires sociaux. Le substantif partenaire prend ici d’ailleurs tout son sens et marque en quelque sorte le rôle de point de suture joué par la formation et que nous avons à plusieurs reprises évoqué.
Les précisions juridiques sur le congé individuel de formation (1978)[26] et sur ses possibilités de financement (1982) permettront pendant une quinzaine d’années aux individus d’espérer se développer en dehors de toute exigence professionnelle[27]. Dans cette possibilité se retrouve une fois encore ce souhait consensuel de ne pas faire de la formation un objet de rupture entre l’homme et l’organisation.
Le retournement des années 80
Il convient maintenant de pondérer ce propos sur la recherche de ce consensus. De nouvelles données depuis un peu plus de dix ans ont, selon nous, redonné une actualité à une logique de tension que la reconstruction et les “trente glorieuses” avaient quelques peu estompées. Nous n’avons pas le recul d’un siècle pour étayer nos affirmations, toutefois, certains indicateurs nous laissent penser que la logique rupture-suture est encore d’actualité. Nous présenterons quelques arguments en ce sens. De nombreux observateurs ont constaté que, dans les dernières années, la suprématie de l’organisation sur l’individu s’est encore accentuée. La plupart des formations s’organisent sur un axe strictement professionnel au point que, lorsqu’elles n’ont pas purement et simplement disparu, les formations dites d’épanouissement[28] personnel semblent suspectes. Quant aux possibilités de départ en congé individuel de formation, les accords sur le capital-temps-formation, les ont par un effet mécanique, ou plutôt financier, réduites de moitié. Autre argument, sans doute le plus significatif même si l’on n’en mesure pas toujours bien la portée, c’est la mise en place et l’utilisation massive de la formation, d’abord comme outil de régulation de la crise de l’emploi (1980-1990), puis comme outil de gestion de l’exclusion et de la fracture sociale. Si la classe laborieuse n’est plus dangereuse, certains de ses éléments pourraient le devenir et la formation, par le lien social qu’elle maintient et les capacités économiques qu’elle ménage (allocation-formation-reclassement ou AFR), une fois de plus, se voit dotée de vertus conciliatrices, mais pour combien de temps, avec quelle efficacité réelle et à quel prix pour sa propre image ? Au-delà, il convient pour ces formations “réparatrices” de s’interroger sur leur qualité, de se demander combien de temps pourra tenir une si fragile suture et quelle plaie mal cicatrisée, à terme, elle va révéler. Ne retombe-t-on pas dans des logiques anciennes où certains ne pouvaient accéder, sauf exception et mérite, qu’à l’enseignement primaire, tandis que d’autres en “héritiers” étaient naturellement destinés au secondaire ? Pourra-t-on longtemps encore, pour ces populations, faire jouer à la formation ce rôle de cautère sur une jambe de bois ? Au-delà de ces analyses et pour compléter cet argumentaire, examinons trois faits significatifs récents qui démontrent que le consensus d’autrefois est aujourd’hui largement remis en cause. Nous nous appuierons pour cela, d’abord sur les résultats d’une recherche menée par le CEREQ (Centre d’études et de recherche sur les qualifications), ensuite sur les propos de Dominique de Calan, vice-président du CNPF (Conseil national du patronat français) et enfin sur le Contrat d’Etudes Prospectives (C.E.P.) des organimes de formation récemment publié.
L’étude menée par les chercheurs du CEREQ, conduite sur “un panel qui porte sur la période allant de 1984 à 1992, comprenant au total 112 030 observations réalisées sur 20 635 entreprises”[29], démontre, s’il en était besoin, sur un échantillon représentatif, que l’égalité d’accès à la formation – toujours un peu mythique mais essentielle à la logique de rapprochement du capital et du travail – est plus que jamais remise en cause. Ce qui a pour conséquence, non seulement de réinterroger fortement le consensus accepté par tous les partenaires lors du Protocole de Grenelle mais aussi de renforcer l’hypothèse, si ce n’est d’une rupture, du moins d’une fragilisation accrue de la suture. En effet, “on constate que depuis le début des années 80, les entreprises ont fortement développé leur recours à la formation professionnelle continue dans la perspective d’adapter les compétences des salariés aux transformations du travail et de son organisation. Or, ce resserrement des liens entre plan de formation et recherche d’efficacité productive a suscité des inégalités d’accès à la formation entre catégories de salariés”[30]. Il ne s’agit plus dès lors d’oeuvrer conjointement au développement des hommes et des organisations, donc de la société tout entière, mais d’adapter strictement la main-d’oeuvre aux impératifs des nouveaux procès de production, en d’autres termes de ne plus former que la partie à potentiel du capital humain, celle pour laquelle, un retour sur investissement -formation est prévisible. Ce renforcement de la logique d’utilisation de la formation au service de l’entreprise réanime les divergences d’intérêt. Car “l’ampleur et l’impact sur les pratiques d’entreprise de ces inégalités témoignent des risques d’une divergence apparente entre les objectifs de l’employeur et les attentes des salariés”[31]. Pour les auteurs de cette recherche, les conséquences “du resserrement croissant de la formation autour d’enjeux d’adaptation aux évolutions des techniques ou de l’organisation (…) pourrait conduire à remettre en cause la solidité du lien entre le salarié et son employeur”[32]. Nous sommes sans doute là en face d’une nouvelle donne, qui se situe à la limite mécanique de la rupture du consensus, car aujourd’hui “ne pas accéder à la formation induit un risque d’être exclu de l’entreprise (…). Il s’agit là d’un enjeu particulièrement important au sein des catégories ouvrières, lorsque la présence de travailleurs peu qualifiés est importante”[33]. Dans cette utilisation, la formation apparaît alors, non plus comme facteur d’égalité et de développement sur lequel reposaient les accords anciens, mais comme productrice de sélection sociale et d’exclusion.
Quant aux propos de Monsieur de Calan, ils sont sans ambiguïté : la responsabilité du maintien de la compétence appartient désormais au salarié et non plus à l’employeur, ceux qui y parviendront se garantiront par eux-mêmes du naufrage social. Et si l’entreprise consent encore certains efforts en matière de formation, c’est en raison de ses propres exigences, de sa propre survie, de son propre développement, dans le sens exclusif de son profit. Ce courant du patronat, dont l’UIMM (Union des industries métallurgiques et minières) est le fer de lance, tient un discours apparent de rupture du consensus social que la formation symbolise. Son représentant, aux propos souvent extrêmes, affirme même publiquement qu’aujourd’hui “les entreprises sont prêtes à payer la formation, mais pas les salaires, et encore moins la baisse de la production qu’elle entraîne”, “que la formation se fera bientôt en dehors du temps travaillé”, qu’il serait même, “à titre personnel, favorable au remboursement de la formation à l’entreprise si le salarié, une fois formé, change d’employeur”[34]. Nous sommes ici loin de l’esprit de Grenelle. Certes, tous les membres adhérents au CNPF ne se reconnaissent pas dans ce discours ultra libéral, mais ce qui nous semble particulièrement révélateur, tant à la lecture des travaux du CEREQ qu’à celle des propos de Dominique de Calan, c’est que la remise en cause de la suture-formation n’est pas le fait d’une revendication salariale de rupture sociale mais de celui du courant libéral du patronat français. La logique de la rupture n’appartient plus ici au travail mais au capital. Est-ce un signe des temps et du même coup la fin des logiques anciennes de rapprochement ? Si tel était le cas, la formation, une fois encore, jouerait son rôle d’indicateur et/ou de révélateur des tensions sociales. Il va de soi qu’alors la suture serait en péril.
Le récent rappport réalisé par l’équipe d‘Interface, à la demande du Ministère du Travail et les différents scenarii qui se profilent confirment encore notre analyse sur la dialectique de “suture-rupture” qui se donne à lire dans la formation des adultes. Le Contrat d’Etudes Prospectives[35] et les scenariid’évolution du secteur professionnel,soulignent bien cette tension associatrice-dissociatrice que nous nous avons évoqué. Ainsi, le scénario n° 1, celui de la “régression pédagogique” annonce “le développement d’une formation à deux vitesses”[36] symétrique à la mise en place de la société duale ; le scénario n° 2, celui de “l’élitisme éducatif” prévoit que “les publics se répartissent en trois cercles : les “stratégiques” auxquels on accorde une attention particulière, les “occasionnels”, qui se forment quand ils le peuvent, et les “exclus, écartés du champ de la formation”[37]. Le scénario n° 3, demeure dans la logique consensuelle de 1971, en favorisant dans le cadre “d’une formation contractuelle (…) le rapprochement effectif entre formation et travail”[38] où semble dominer, néanmoins, la logique de l’organisation aux dépens de l’évolution individuelle. Seul, le quatrième et dernier amorce l’idée très fouriériste d’une réconciliation du Capital et du Travail dans l’espace et le temps “d’une société cognitive” marquée par “l’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail (et) le développement des compétences”[39].
Ces quelques pages, qui reprennent brièvement quelques éléments de l’histoire de l’éducation des adultes et quelques faits récents, nous ont montré combien la formation était au centre de multiples contradictions et que, selon les époques, les idéologies et les rapports de force, les usages sociaux que l’on en fait diffèrent. Elle est, selon les acteurs, possibilité d’intégration, outil de modernisation, occasion d’émancipation. Elle peut avoir simultanément pour certains d’entre eux plusieurs usages mais elle n’est jamais neutre. Elle fonctionne souvent aux limites de la rupture, mais souvent aussi à l’initiative de la suture. L’éducation des adultes est en permanence en recherche d’équilibre entre ceux qui souhaitent en faire une fonction serve à la discrétion des organisations et ceux qui souhaitent en faire un levier pour libérer l’individu et le monde. Position contrastée et tension ultime qui nous amènent à nous demander si la formation – parce que toujours située sur une ligne de fracture sociale – en paraphrasant Yves Lacoste et en forçant un peu le trait, ça ne sert pas comme la géographie, à faire la guerre ?
Dépasser la contradiction
En effet, à y regarder de près, les termes de la contradiction, ceux qui positionnent la formation entre rupture en suture, n’ont pas radicalement évolué sur le fond, même si la forme durant “les trente glorieuses” s’était légèrement adoucie. Ils reflètent toujours la difficulté, pour ne pas dire le refus de certains, de penser le développement conjoint de l’homme et de l’organisation. Il ne s’agit pas ici de simples appréciations conjoncturelles mais de visions du monde radicalement différentes qui se traduisent par “deux conceptions opposées de la formation qui n’expriment pas un simple désaccord pédagogique mais la lutte de classes au sein de la formation professionnelle”[40]. Sans aller, jusqu’à affirmer que rien n’a fondamentalement changé depuis 1848, et que certains pensent toujours “que l’esprit de libre examen, chez les pauvres surtout, prédispose au socialisme”[41], il faut noter que la formation qui fit consensus pendant la période récente et les discours qui l’accompagnent reflètent à nouveau une tension-exclusion sociale de plus en plus présente.
Si, “nos ouvriers ont (toujours) de plus en plus besoin d’intelligence pour être en état de diriger les machines”[42], les gains de productivité, réalisés du fait de l’automatisation constante des équipements industriels et des opérations nécessaires à la réalisation des activités du tertiaire, nécessitent une main d’oeuvre toujours moins nombreuse. Ce constat rend les perspectives des scenariin° 1 et n° 2 proposés par Bernard Masingue, sinon probables, du moins crédibles. En ce cas, la rupture serait consommée, la formation ne serait plus créatrice de lien social mais outil de discrimination sociale.
Afin d’éviter cette fracture définitive entre formation et travail, peut-être convient-il, une fois de plus, de revenir au XIX èmesiècle et à ses utopies dont les objectifs visaient explicitement à réduire les contradictions sociales, à dépasser la fracture. Dans ce sens une relecture de l’oeuvre de Charles Fourier, articulée aux concepts contemporains d’organisation qualifiante et de développement personnel – passionnel aurait écrit l’utopiste – pourrait nous aider à redonner du sens à la formation puisque pour lui, dans le monde sociétaire, “l’éducation harmonienne” a pour but “l’Unité” et l’association – sans doute dépassable – du Capital et Travail[43]. L’enjeu est toujours le même : construire dans l’avenir un Nouveau Monde Industriel et Sociétaire – celui où le savoir est à la fois festif[44], productif et libérateur – et non pas tenter un retour à un âge d’or mythique.
Comme le souligne Pierre-Joseph Proudhon, il s’agirait “de développer par une éducation intégrale, comme disait (déjà) Fourier, le plus grand nombre d’aptitudes et de créer la plus grande capacité possible”[45] pour chaque individu dans le cadre d’une éducation “tellement conçue et combinée qu’elle dure à peu près toute la vie” et qu’elle soit ainsi “la première garantie de notre dignité et de notre félicité”[46]. En bref, et pour paraphraser Albert Thierry, peut-être est-il souhaitable de redonner à l’éducation des adultes (à l’initiale sans doute aussi) un peu d’utopie originelle en lui assignant comme but ultime de concourir à rétablir chez l’homme, dans un souci de suture réaffirmé, une part de cette “plénitude d’humanité”[47] dont tant de générations ont rêvé.
Hugues LENOIR
CEP Paris X
[1] Allusion à une association fondée en 1831, dissoute en 1832 par le pouvoir, dont le nom était : Association pour l’instruction gratuite du peuple.
[2] Voir Lenoir H., Syndicalisme et formation, Actualité de la formation permanente, octobre-novembre, 1998
[3] Grand Larousse universel, Paris, Larousse, 1989, t. 14.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] En référence à l’objet transitionnel de Winnicott D. W., cf. : Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975.
[7] Le Petit Robert, Paris, 1972.
[8] Proudhon P.-J., De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Les éditions de Monde libertaire, 1977, t. 2, p. 337. Le propos de Proudhon concerne, dans le texte, non pas la formation mais l’école. Nous utilisons cette citation car nous pensons que l’auteur, dans un autre contexte, aurait pu l’appliquer à l’éducation des adultes.
[9] Terrot N., Histoire de l’éducation des adultes en France, Paris, Edilig, 1983, p. 38.
[10] Ibid., p. 41, Noël Terrot se réfère ici à Maurice Dommanget.
[11] Ibid., p. 61.
[12] Ibid., p. 61.
[13] Ibid., p. 66.
[14] Louis Legrand cité par Foucambert J., l’Ecole de Jules Ferry, Paris, Retz, 1986, p. 58.
[15] Terrot N., op. cit., p. 134.
[16] Charlot B., Figeat M., Histoire de la formation des ouvriers, 1789-1984, Paris, Minerve, 1985,
p. 232.
[17] Dolléans E., Histoire du mouvement ouvrier, Paris, A. Colin, 1967 (3 tomes), p. 11 citation en exergue à la première partie du tome 2.
[18] Terrot N., op. cit., p. 168.
[19] Ibid., p. 173.
[20] Fernand Pelloutier, Compte rendu du Ve congrès de la CGT, Rennes, cité par Juillard J., Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d’action directe, Paris, Seuil, 1971, p. 243.
[21] Terrot N., op. cit., p. 230.
[22] Ibid., p. 260.
[23] Article L. 900-1 du Code du travail.
[24] Ibid.
[25] Les Fiches pratiques de la formation continue, Paris, Centre Inffo, 1997, p. 17.
[26] Loi du 17 juillet 1978 et avenant du 21 septembre 1982 à l’accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 que la loi du 24 février 1984 intégrera.
[27] Il s’agit ici d’un principe, les orientations des organismes gestionnaires paritaires ont très largement perverti cette possibilité a-professionnelle. Les statistiques du COPACIF font état de 3 à 4 % de CIF strictement non professionnels.
[28] Nous employons le terme épanouissement et non pas développement, car ce dernier est très en usage dans le cadre de la formation au management donc au service de l’organisation.
[29] Aventur F., Handache S., Formation continue et justice sociale dans l’entreprise, CEREQ, Bref, n° 136, novembre 1997, p. 1.
[30] Ibid., p. 1.
[31] Ibid, p. 1.
[32] Ibid., pp. 3-4.
[33] Ibid., p. 4.
[34] Entreprises et Carrières, n° 416, 6 décembre 1997.
[35] Les résultats de cette étude pilotée par Bernard Masingue sont à paraître à la Documentation française (1998). La presse professionnelle en a déjà publié les grandes conclusions, cf. : Masingue B., Putot A., Organismes privés de formation : Le contrat d’études prospectives, Actualité de la formation permanente, n° 150, septembre-octobbre, 1997.
[36] Les organismes de formation, synthèse prospective formation emploi, Paris, Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1998, p. 23.
[37] Ibid., p. 24.
[38] Ibid., pp. 24-25.
[39] Ibid., p. 25.
[40] Charlot B., Figeat M., op. cit., p. 137.
[41] Agulhon M., 1848 ou l’apprentissage de la République (1848-1852), Paris, Seuil, 1992, p. 163.
[42] Journal des Instituteurs (1866), cité par Labelle J.-M., La réciprocité éducative, Paris, PUF, 1996, p. 67.
[43] Cf. A ce propos : Fourier C., Théories de l’Unité Universelle, Paris, Anthropos, 1971, Oeuvres complètes, t. 5 et Lenouveau monde industriel et sociétaire, Paris, Flammarion, 1973,section III.
[44] Allusion à l’ouvrage d’Henri Desroches : La société festive, du fouriérisme écrit aux fouriérismes pratiqués, Paris, Seuil, 1975.
[45] Proudhon P.-J., De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Les éditions du Monde Libertaire, 1977, t. 2, p. 346.
[46] Ibid., p. 346.
[47] Cité par Dommanget M., Les grands socialistes et l’éducation : de Platon à Lénine, Paris, A. Colin, 1970, p. 402.